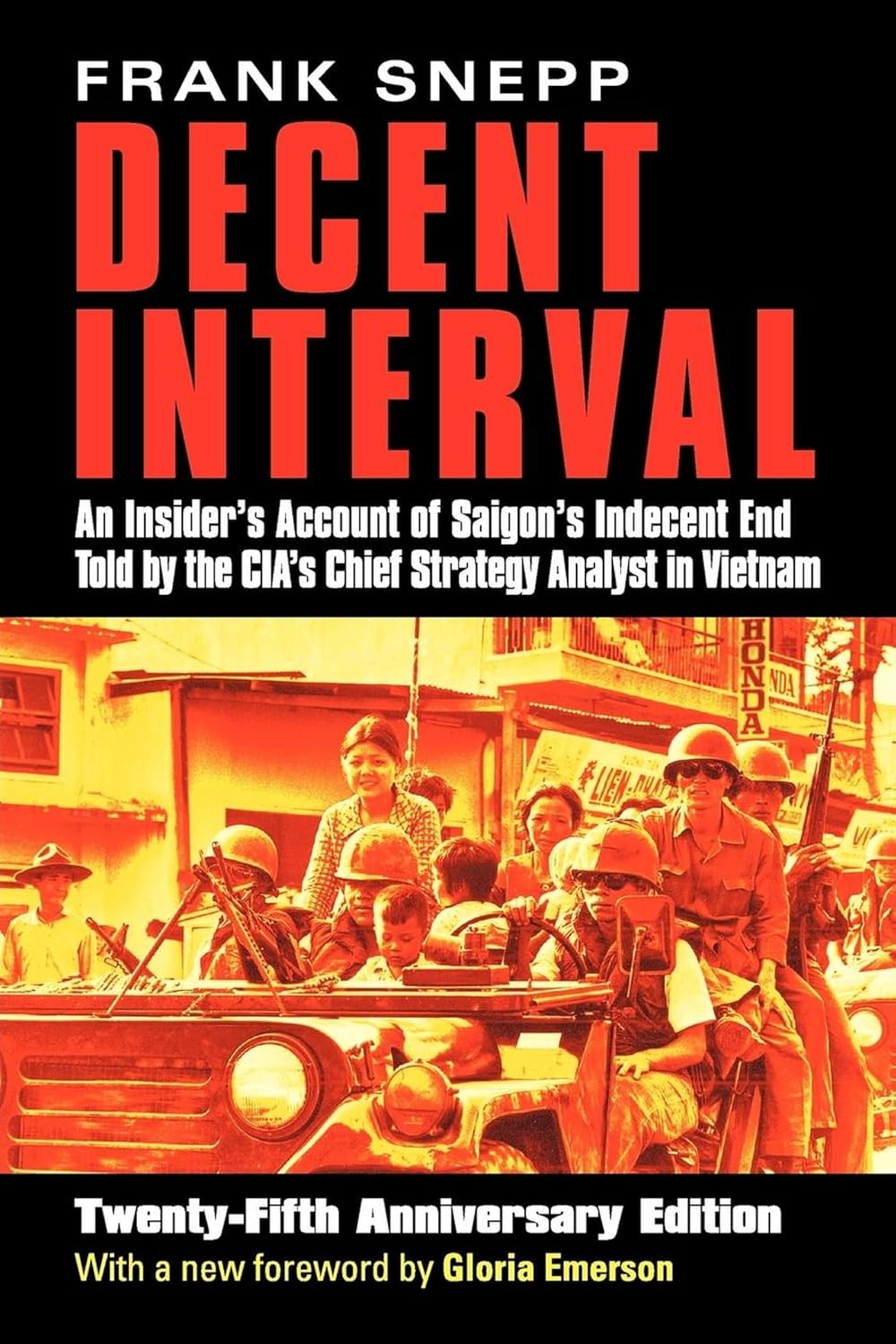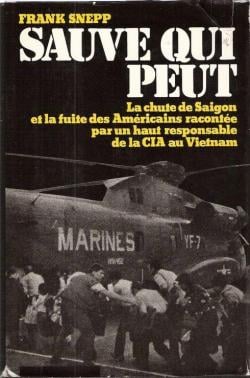Article de Frank Snepp : "De Truman à Trump, le triomphe de la présidence impériale" ! Newsletter Vincent Ricouleau, Professeur de droit.
Passionnant article de Frank Snepp, "De Truman à Trump, le triomphe de la présidence impériale", publié le 21 novembre 2025. Snepp, ex CIA, qui a vécu la chute de Saigon, mais aussi le Vietnam d'avant et d'après, auteur de "Decent Interval", traduit en français "Sauve qui peut", livre qui lui a valu tant de problèmes judiciaires avec la CIA.


Passionnant, éclairant et long article de Frank Snepp, "De Truman à Trump, le triomphe de la présidence impériale", publié le 21 novembre 2025. Snepp, ex membre de la CIA, qui a vécu la chute de Saigon de A à Z, mais aussi expert du Vietnam d'avant et d'après, auteur de "Decent Interval", traduit en français sous le titre de "Sauve qui peut", livre qui lui a valu tant de problèmes judiciaires avec la CIA.
https://franksneppexclusives.com/?p=745
Voici la traduction de l’article.
“Un autre opposant à Trump m'a rappelé l'autre jour que mes propres péchés avaient contribué à élever DJT au rang de quasi-despote.
Ça m'a gâché la matinée. Mais il y avait du vrai là-dedans.
Il faisait référence à une affaire portée devant la Cour suprême qui porte mon nom, une affaire que j'ai perdue, et à son rôle dans l'élargissement de la voie légale vers une autorité présidentielle sans limites, ce pouvoir même que Trump recherche et qu'il est dangereusement proche d'obtenir.
Oui, je me rends compte que c'est une entrée en matière assez abrupte pour un article d'opinion, même pour un pavé comme celui-ci.
Et comme je ne suis pas avocat, mais seulement un misérable souffre-douleur dans l'un des chapitres mineurs du droit constitutionnel, je suis loin d'être qualifié pour donner des leçons sur la façon dont les arrêts de la Cour suprême ont permis à notre président impérial d'exercer son pouvoir.
Dans ma jeunesse, Richard Nixon incarnait à la perfection les dangers d'un dirigeant aux ambitions royales. J'ai survécu à son régime, de justesse, lors de mon service à la CIA au Vietnam. Mais Trump a depuis longtemps surpassé Nixon en matière de pouvoir absolu, et, comme la plupart des experts vous le diront, la Cour suprême porte une part de responsabilité.
Alors, malgré mon absence de qualifications juridiques, il me semble naturel de demander : comment cela s'est-il produit ?
Ma première réponse instinctive, en tant que nerd, me ramène à Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer , 343 US 579, une ancienne décision de la Cour suprême surnommée « l'affaire de l'acier ».
Voilà ce qui arrive quand on perd un procès important : on est obsédé par ce qui aurait pu être. Pour moi, cette obsession a toujours été Youngstown .
Lorsque le ministère de la Justice m'a traîné en justice en 1978 pour avoir écrit un livre qui déplaisait à la CIA, mes vaillants avocats m'ont assuré qu'il ne s'agissait que d'un abus de pouvoir présidentiel déguisé en artifice juridique. Ils ont affirmé que cela violait mon droit à la liberté d'expression et allait bien au-delà de ce qu'un président agissant par l'intermédiaire du ministère de la Justice pouvait constitutionnellement faire.
Pour me rassurer, ils m'ont indiqué Youngstown. Et leurs propos étaient si rassurants que cette décision est devenue une sorte de doudou. À l'époque, je plaisantais à moitié en disant que je dormais avec une copie sous mon oreiller.
Bon, j'exagère un peu, mais vous comprenez l'idée.
En réalité, cette ancienne décision aurait dû me protéger. Et elle devrait aujourd'hui contraindre Trump. Mais, en tant que précédent, l'arrêt Youngstown s'est révélé inefficace. Cet échec explique mieux que presque n'importe quel texte de loi la montée en puissance de l'autocratie à la Maison-Blanche.
Maintenant que j'ai toute votre attention, permettez-moi de vous faire faire un tour d'horizon simplifié du paysage juridique qui a engendré ce monstre parmi nous.
Tout d'abord, bien sûr, l' histoire de Youngstown .
Attachez votre ceinture et essayez de ne pas vous ennuyer.
Youngstown – La Promesse
En avril 1952, le président Harry Truman, confronté à une grève des métallurgistes pendant la guerre de Corée, ordonna la réquisition fédérale des aciéries. Il affirmait que l'effort de guerre exigeait un approvisionnement continu en acier et que le président avait le pouvoir intrinsèque de le garantir.
La Cour suprême n'était pas d'accord.
Le juge Robert Jackson, tout juste rentré de Nuremberg, a défini les paramètres qu'il jugeait appropriés . Le pouvoir présidentiel, écrivait-il, se divise en trois catégories. Il est à son apogée – dans sa légalité maximale – lorsqu'il est autorisé par le Congrès (en présence d'une loi sanctionnant l'action). Il bascule dans une zone grise, moins justifiable, lorsque le Congrès reste silencieux (n'ayant adopté aucune loi pertinente). Enfin, il atteint son point le plus bas lorsque le président agit à l'encontre du Congrès et de la loi .
C'était un constitutionnalisme clair et pragmatique. En clair : les présidents ne peuvent pas s'octroyer de nouveaux pouvoirs (ou fédéraliser les aciéries) sur un coup de tête, surtout lorsque ces pouvoirs contreviennent à la loi ou à la Déclaration des droits.
Pendant des décennies, le test tripartite de Jackson a semblé être un frein aux aspirants potentats.
Mais la Cour a également laissé une porte entrouverte. Il existait un autre précédent , Curtiss-Wright (1936), qui considérait le président comme le « seul organe » de la politique étrangère, doté d'une latitude particulière en matière de sécurité nationale.
Youngstown a mis en garde contre les abus de pouvoir de l'exécutif. Curtiss-Wright a évoqué à voix basse la notion de prérogative.
Ce murmure allait se faire plus fort.
Mon cas — De la Constitution au contrat
Le 29 avril 1975, j'étais parmi les dix-sept derniers agents de la CIA à être évacués du toit de l'ambassade américaine à Saïgon, alors que les forces ennemies se rapprochaient. Bien que privé de la plupart de mes illusions et de mes biens matériels, je conservais la certitude que les services de renseignement auraient dû nous réserver un meilleur sort.
Pendant près de six ans, dont cinq sur place, j'ai été l'un des principaux évaluateurs de la CIA chargés d'analyser les intentions ennemies, avec un accès privilégié aux sources clés et aux dossiers de renseignement. Je savais pertinemment quels avertissements avaient été ignorés par Nixon, Kissinger, Ford et leurs plus proches collaborateurs à Saïgon et à Washington.
Ainsi, au milieu des décombres de ma conscience, je me sentais tenu de demander des comptes, afin que nous ne commettions plus jamais les mêmes erreurs, et d'assurer le sauvetage de nos amis vietnamiens restés sur place.
Mais à Washington, au sein des instances officielles, on ne souhaitait rien d'autre que l'amnésie ou la dissimulation. Tout en repoussant systématiquement les propositions d'analyse post-événementielle, Kissinger, son ancien ambassadeur à Saïgon et divers acolytes laissaient fuiter des informations à profusion pour se dédouaner de toute responsabilité dans ce qui avait mal tourné.
Dégoûté et désespéré, j'ai quitté la CIA pour écrire mon propre bilan et le publier sous forme de livre, dans l'espoir de faire honte à quelqu'un et de le pousser à réparer ses erreurs.
Quelle idiote !
En partant, j'ai fait part de mes intentions aux agents de sécurité de l'Agence, mais je les ai assurés que je ne révélerais aucun secret, car le mal était déjà fait. Un an plus tard, j'ai tenu les mêmes propos à Stansfield Turner, le directeur de la CIA sous Carter, ne laissant aucun doute sur mes intentions, même si l'Agence tenterait par la suite de me faire passer pour un menteur.
En novembre 1977, Decent Interval fit ses débuts sous les feux des projecteurs médiatiques. Immédiatement, le ministère de la Justice de Carter, sous l'impulsion du directeur Turner, engagea contre moi une procédure majeure pour atteinte à la sécurité nationale.
Les avocats du ministère de la Justice ont reconnu sous serment que mon livre ne contenait ni secrets ni informations non publiques . ( Oui, vous avez bien lu.) Mais ils ont insisté sur le fait que sa publication sans autorisation avait causé un « préjudice irréparable » à la nation en sapant la confiance dans les procédures de sécurité de la CIA.
Ils n'ont fourni aucune preuve, mais ont exigé que je cède au Trésor américain tous les bénéfices du livre, maintenant et à jamais, et que je me soumette à une interdiction de publication à vie, m'interdisant d'écrire à nouveau sur mes expériences au sein de la CIA, la guerre et tout ce qui s'y rapporte (quoi que cela signifie) sans autorisation officielle.
L'absence de toute allégation de violation de la sécurité ou de réclamations de dommages-intérêts prouvables a rendu cette affaire unique.
Il ne s'agissait pas d'une réplique de l' affaire des Pentagon Papers de 1971, où l'administration Nixon avait tenté (sans succès) d' empêcher la publication de documents de sécurité nationale hautement classifiés.
Il s'agissait d'une affaire civile, et non d'une affaire relevant des lois sur l'espionnage criminel.
Et comme me l'ont expliqué mes avocats, cela relevait clairement du précédent de Youngstown , car rien dans la loi ne donnait au président l'autorité explicite de punir la publication non approuvée d' informations non secrètes ou de réduire au silence l'auteur fautif.
De fait, selon eux, le nouveau système de révision avant publication de la CIA ne bénéficiait d'aucun cadre légal explicite, contrairement à ce qu'exigeait l'arrêt Youngstown . Ils estimaient qu'il basculait largement dans la zone rouge définie par l'arrêt Jackson, relative au pouvoir présidentiel implicite , une notion floue.
Cela m'a remonté le moral.
Mais les gens du ministère de la Justice n'étaient pas des imbéciles. Plutôt que d'affronter Youngstown de front, ils ont offert aux tribunaux un assortiment d' arguments juridiques à exploiter.
Pour satisfaire aux exigences de Curtiss-Wright , ils ont inventé une justification sécuritaire pour me discréditer, arguant que mon indiscipline avait inquiété des alliés. Ils ont également averti que des individus peu scrupuleux de mon rang pourraient ne pas avoir une vision d'ensemble et risqueraient de divulguer involontairement des informations sensibles si nous étions autorisés à publier sans contrôle.
Peu importe que cet argument politique ne me concernât pas puisque j'avais des secrets protégés,
Finalement, par mesure de précaution, les autorités fédérales ont épluché une pile de contrats de travail souvent contradictoires que j'avais signés à différents moments de ma carrière, certains exigeant une habilitation uniquement pour les documents classifiés, un autre prétendant tout couvrir – et ont insisté arbitrairement sur le fait que la version la plus large prévalait.
Et quand cette situation a commencé à devenir instable, ils ont puisé dans les vieux recueils de la common law britannique, prétendant que j'avais violé une obligation de confiance implicite et que je devais donc restituer mes « gains mal acquis », comme si les droits d'auteur d'un livre n'étaient pas différents d'un cheval volé.
Chacune de ces théories était bancale et non éprouvée. Mais ensemble, elles offraient aux tribunaux un moyen d'éviter l'arrêt Youngstown et le droit constitutionnel et de réduire mon affaire à un simple litige contractuel.
Le juge de première instance a mordu à l'hameçon et a statué contre moi sans convoquer de jury. En appel, la Cour d'appel du quatrième circuit, à Richmond, a proposé un compromis : je devais faire certifier tous mes écrits futurs, mais le gouvernement devait prouver le préjudice devant un jury s'il voulait me condamner financièrement.
Si vous avez la tête qui tourne, imaginez ce que j'ai ressenti.
Mais le juge Walter E. Hoffman s'est alors prononcé en désaccord. Il a rejeté le compromis de la majorité et adopté la théorie la plus radicale du gouvernement. Qualifiant mes actions de trahison, il a réclamé la création d'une « fiducie constructive » qui transférerait l'intégralité de mes redevances au gouvernement sans qu'il soit nécessaire de prouver un quelconque préjudice.
Un an plus tard, la Cour suprême adopta presque intégralement le point de vue de Hoffman. Dans une décision laconique et non signée rendue à l'unanimité , six juges ordonnèrent la confiscation de tous mes revenus et la restriction de mes droits constitutionnels. Reprenant à leur compte les arguments fallacieux du gouvernement, ils déclarèrent que le simple refus d'autorisation de publication de mon manuscrit avait gravement porté atteinte à la sécurité nationale.
Remarquez ce que la Cour n'a pas fait. Elle n'a jamais examiné les arguments du gouvernement au regard de l' arrêt Youngstown . Elle n'a pas cherché à savoir si le Congrès avait autorisé la censure préalable par contrat de travail. En requalifiant la censure en « devoir fiduciaire » implicite découlant de mon « contrat », comme s'il n'en existait aucun de contradictoire, la Cour a complètement éludé la question du Premier Amendement. La logique de Hoffman, plus gourmande que conforme à la jurisprudence, est devenue la loi du pays.
Pour vous donner une idée du caractère radical de cette décision, considérez les fondements de l'ère Nixon. Durant son propre règne impérial, il s'était arrogé le droit présidentiel inhérent de mettre sur écoute des citoyens, de bombarder le Cambodge, d'ignorer les citations à comparaître et de s'emparer purement et simplement des leviers du pouvoir. Les tribunaux s'y étaient opposés , citant souvent l'arrêt Youngstown .
Mais cette fois, la Cour suprême a répondu : Youngstown? Quel Youngstown? Changeons de perspective. Faisons comme si de rien n’était.
Grâce à cette habile modification, l'affaire États-Unis contre Snepp s'est transformée en un différend restreint concernant les conditions d'emploi, ce qui a permis à six membres de la Fraternité d'en faire une nouvelle autorisation pour les excès présidentiels.
Moralité : lorsque l'État souhaite imposer une censure préalable, qu'il appelle cela l'application d'un contrat.
La leçon plus profonde est que les limites constitutionnelles peuvent être contournées non seulement par la force brute, mais aussi par une habile reformulation. L’avertissement de Youngstown – selon lequel le président est au plus bas lorsqu’il agit sans le Congrès – a ainsi été neutralisé.
Pour moi, les conséquences furent désastreuses : un compte bancaire à sec, une interdiction de parler à vie d’une ampleur incalculable et une réputation réduite à néant, frôlant la trahison. L’affaire Snepp contre les États-Unis n’a peut-être pas la même portée que l’arrêt Youngstown , mais elle illustre la facilité avec laquelle les contraintes constitutionnelles peuvent être bafouées.
Et il y a encore d'autres raisons de se plaindre.
Outre le principe constitutionnel, l'arrêt Snepp a bouleversé les normes procédurales. Dès que mes avocats eurent demandé une audience à la Cour et que le gouvernement eut répliqué, les Frères se sont précipités et ont tranché l'affaire sans permettre à aucune des parties de déposer des mémoires écrits, et encore moins de présenter des plaidoiries. La Cour a ainsi rendu un jugement sommaire apparemment fondé sur des décisions de juridictions inférieures et des articles de presse.
Un matin, alors que j'attendais nerveusement de savoir si les Neuf allaient prendre mon affaire en charge, mon avocat principal, Mark Lynch, m'a appelé d'un ton morne pour me dire qu'ils l'avaient non seulement acceptée, mais qu'ils avaient pris leur décision sans même l'avoir examinée, sans avoir entendu les arguments.
Ce n'était pas la première fois que la Cour statuait de manière aussi superficielle. Cela s'était produit environ 400 à 600 fois depuis la fondation de la République. Mais les circonstances précises de l'affaire Snepp , notamment le fait que le gouvernement s'était joint à nous pour demander une audience complète, étaient extrêmement rares.
Cette pratique s'est répandue. En court-circuitant le processus décisionnel, la Cour Snepp anticipait le recours croissant, de nos jours, de la Cour Roberts à la « procédure parallèle » — des diktats non débattus émanant d'en haut — pour remodeler ou résoudre temporairement des litiges constitutionnels majeurs sans audiences complètes.
Si vous avez eu du mal à rester éveillé jusqu'à la fin, sachez que j'ai mis votre patience à rude épreuve précisément parce que l'affaire Snepp était un tournant pour aujourd'hui. Bien que personne n'ait pu le prévoir, cette affaire et son traitement ont préfiguré la voie empruntée par la Cour pour étendre les pouvoirs présidentiels, jusqu'à l'ère Trump 2.0, en recourant à des raccourcis procéduraux, à des raisonnements euphémistiques et à des manœuvres dilatoires visant à invalider l'arrêt de Youngstown .
De plus, si la responsabilité est le remède naturel aux abus du pouvoir exécutif, à l'instar de Donald Trump, la décision Snepp a constitué un premier pas majeur dans la mauvaise direction. Tout initié souhaitant dénoncer les abus de pouvoir présidentiels doit désormais composer avec le risque d'être « sneppé » à vie : réduit à la misère et soumis à une censure permanente, que des secrets d'État soient ou non en jeu.
L'administration Reagan a réagi en imposant des « contrats » de censure à un grand nombre de fonctionnaires, y compris des employés du Service des forêts des États-Unis. Aujourd'hui, des millions d'employés et d'anciens fonctionnaires, de John Bolton à Edward Snowden – et même des journalistes au Pentagone sous Trump – subissent une censure comparable à celle instaurée par Snepp .
Bienvenue dans 1984, version orwellienne.
Rebond
Après le revers cuisant de la Cour suprême, il m'a fallu trois ans de galère, à emprunter sans vergogne à ma famille et à mes amis, pour commencer à me remettre sur pied. Finalement, plusieurs journalistes qui m'avaient connu au Vietnam ou qui étaient fans de Decent Interval ont eu pitié de moi et m'ont fait embaucher comme consultant pour ABC News. Intégré à leur équipe d'investigation, j'ai contribué à révéler le scandale Iran-Contra. Dès lors, de nouveaux horizons se sont ouverts. Le journalisme est devenu ma nouvelle passion.
Au cours des deux décennies suivantes, j'ai couvert le renversement du dictateur panaméen Manuel Noriega par la première administration Bush (qui agissait sans l'aval du Congrès), l'affaire Monica Lewinsky et de nombreux autres abus de pouvoir présidentiels. Parallèlement, une multitude d'affaires de corruption politique et d'entreprises sont venues s'ajouter à ces reportages.
En 2001, une Chinoise pleine de vie m'a donné une fille, le plus beau cadeau que j'aie jamais reçu. Elle a aussi contribué à éveiller mon intérêt pour la manière dont les dirigeants du parti à Pékin ont perverti le pouvoir à leur profit. L'ascension ultérieure de Donald Trump a rendu ces enseignements pertinents pour la politique intérieure américaine.
Je ne vous dis pas cela pour « humaniser » le récit, comme le prétendent certains influenceurs des réseaux sociaux. Je veux simplement préciser que la décision de la Cour suprême dans l'affaire Snepp ne m'a pas anéanti. D'autres prétendus lanceurs d'alerte – comme mon ami, feu Dan Ellsberg – se sont spécialisés dans la démagogie sur divers sujets politiques après leurs premières révélations. Pas moi. Le fanatisme a tendance à alimenter le fanatique. J'ai pensé que le détachement et la distance propres au journalisme me permettraient de préserver une part d'humanité.
Perspective
Pour quiconque s'efforce de documenter les dernières difficultés de la présidence impériale, il est bon de rappeler que la dernière déclaration de guerre officielle du Congrès américain remonte à 1941, après Pearl Harbor. Depuis lors, chaque intervention militaire repose sur une interprétation déformée du pouvoir présidentiel ou sur les impératifs politiques du moment.
Le recadrage est devenu la norme. Qu'on l'appelle « opération de police », « mission de maintien de la paix » ou « autorisation d'emploi de la force militaire », le président peut jouer les justiciers solitaires, envoyant des troupes au combat avec pour seul argument l'approbation du Congrès.
Il est également devenu un fait établi que, la déclaration de guerre étant devenue une prérogative présidentielle, d'autres pouvoirs autrefois partagés avec le Congrès ont subi le même sort. Nous nous sommes tellement habitués à cette perversion du dessein originel que nous n'y prêtons presque plus attention.
Ainsi, lorsque nous commencerons à chercher des responsables de l'ignominie qu'est Donald Trump, nous pourrions bien commencer par nous remettre en question. Le pouvoir américain s'est depuis longtemps orienté vers l'exécutif – un arc-en-ciel maléfique qui s'étend à travers le firmament constitutionnel.
Si vous en doutez, regardez la vidéo.
Lorsque Truman a cherché à s'emparer des aciéries, il s'inspirait du concept de pouvoir présidentiel qui avait déjà déclenché la guerre de Corée. Le Congrès n'a jamais formellement déclaré cette guerre ; elle a été menée comme une « opération de police » en vertu d'une résolution de l'ONU.
Nous savons tous désormais comment Lyndon Johnson nous a entraînés de force dans la guerre du Vietnam. Il a fabriqué suffisamment de demi-vérités autour d'un incident mineur impliquant des canonnières nord-vietnamiennes pour inciter le Congrès à adopter la résolution du golfe du Tonkin, une déclaration de guerre de facto et sans fin, sans vote formel.
Vint ensuite Richard Nixon. Dans un pays déchiré par les tensions raciales et les manifestations contre la guerre, il chercha à apaiser sa « majorité silencieuse » en adoptant une ligne dure et en mettant à l'épreuve la jurisprudence de Youngstown à chaque occasion. À l'étranger, il bombarda secrètement le Cambodge et le Laos et lança même une invasion terrestre du Cambodge, le tout sans l'approbation du Congrès. Dan Ellsberg riposta en divulguant les Pentagon Papers, un document top secret relatant comment l'Amérique s'était engagée par erreur dans le conflit vietnamien. Nixon tenta alors de faire taire la presse. La Cour suprême le débouta en invoquant le Premier Amendement et en reprenant le raisonnement du juge Jackson dans l'arrêt Youngstown .
Parallèlement, face à l'escalade des manifestations, Nixon fit écouter des journalistes, autorisa des cambriolages et créa une unité secrète pour harceler ses détracteurs. Il s'arrogea également le pouvoir de bloquer les fonds votés par le Congrès (« blocage des crédits ») et invoqua le large privilège de l'exécutif pour maintenir secrètes les enregistrements de la Maison-Blanche. Il fallut attendre le procès États-Unis contre Nixon en 1974 pour lui rappeler que même un président n'est pas au-dessus des lois.
Rétrospectivement, la « présidence impériale » de Nixon (pour reprendre l'expression d'Arthur Schlesinger) se caractérisait par un comportement typique de la catégorie 3 selon l'arrêt Youngstown: l'exercice du pouvoir non seulement sans l'aval du Congrès, mais aussi en violation de celui-ci. Ses bombardements secrets, ses saisies de biens et ses campagnes de surveillance étaient présentés par ses défenseurs comme des mesures nécessaires, mais il s'agissait en réalité d'affirmations unilatérales de son autorité, ce type même d'immunité « monarchique » face au contrôle que le juge Jackson avait mis en garde.
Même en matière de diplomatie, où les présidents bénéficient traditionnellement d'une certaine marge de manœuvre, Nixon s'appuyait sur le langage vague de la loi Curtiss-Wright pour justifier des accords exécutifs et des arrangements secrets, ignorant superbement la mise en garde de Youngstown selon laquelle le pouvoir présidentiel n'est pas illimité. Plus encore que la saisie des aciéries par Truman, c'est la conduite de Nixon qui a démontré la fragilité des limites constitutionnelles lorsqu'un président les considère comme des obstacles à contourner. Sa chute lors du Watergate fut l'aboutissement de cette mentalité.
Parallèlement, les démocrates ont entrepris de réduire le financement des opérations américaines au Vietnam et, en 1973, peu après le cessez-le-feu, le Congrès a adopté la résolution sur les pouvoirs de guerre, interdisant à tout président d'engager les forces américaines dans des hostilités à l'étranger pendant plus de soixante jours sans l'approbation du Congrès. Ce fut une étape cruciale dans les efforts visant à rétablir l'équilibre constitutionnel entre les trois pouvoirs.
Peu après, le Congrès lança les enquêtes Church et Pike sur les abus de la CIA récemment révélés, notamment des complots d'assassinat approuvés par le président. Le président Gerald Ford réagit en acceptant un nouveau régime de contrôle parlementaire. Il créa également une forme d'immunité présidentielle implicite en accordant une grâce controversée à Richard Nixon.
Mais nombreux étaient ceux, à droite, qui bouillonnaient encore d'amertume face à notre humiliation au Vietnam et qui s'employaient systématiquement à imputer les maux du pays aux démocrates libéraux et modérés. S'ensuivirent la crise des otages en Iran et l'invasion soviétique de l'Afghanistan, deux événements qui attisèrent le mécontentement envers l'administration Carter. Une avalanche de fuites embarrassa Carter et le directeur de la CIA, Turner. Le président réagit comme nombre de ses prédécesseurs confrontés à des difficultés : il réprima la dissidence, s'alliant brièvement aux conservateurs qui s'irritaient des critiques formulées par des membres de l'establishment. D'une certaine manière, l'affaire États-Unis contre Snepp découlait de cette intolérance bipartisane à l'égard de la dissidence.
Au milieu de cette agitation, le charismatique Ronald Reagan s'est imposé. Promettant de libérer les Américains encore détenus à Téhéran, il a galvanisé les électeurs lassés du malaise national et a infligé une défaite retentissante à Carter. Nombre d'observateurs ont interprété les résultats de 1980 comme un désaveu du « lobby de la responsabilité », dont l'obsession du contrôle parlementaire était perçue comme une erreur délibérée.
Une fois au pouvoir, Reagan proclama « L'aube de l'Amérique » et lança le Projet Démocratie , un ensemble d'initiatives secrètes et publiques visant à endiguer le communisme partout où il pointait son nez. L'un des plus fervents défenseurs du Projet, Oliver North, vétéran du Vietnam amer, commença à mettre sur pied, avec la bénédiction de Reagan, un réseau secret de mercenaires, d'intermédiaires israéliens et d'unités clandestines nouvellement créées au sein du Pentagone, exemptées du contrôle imposé à la CIA. Pour North, une trop grande transparence avait coûté la victoire à l'Amérique au Vietnam.
La présidence impériale était de retour aux affaires, et les avertissements du juge Jackson réclamaient d'être entendus.
Reagan – polissant le sceptre
L'ampleur des abus de pouvoir de Reagan était non seulement stupéfiante, mais aussi extrêmement séduisante pour d'autres adeptes de Burke des temps modernes . À maintes reprises, son administration a démontré comment les présidents pouvaient étendre leurs pouvoirs non pas en violant ouvertement la Constitution, mais en agissant rapidement, en rebaptisant la mission et en laissant ensuite le Congrès et les tribunaux régler le problème.
Face à la montée des tensions au Liban, il déploya des Marines en tant que « forces de maintien de la paix ». Lorsque des affrontements éclatèrent et qu'un attentat-suicide coûta la vie à 241 Américains, le Congrès insista pour que la résolution sur les pouvoirs de guerre exige un retrait. Reagan nia même que des « hostilités » aient eu lieu. Les parlementaires finirent par trouver un compromis, lui laissant carte blanche pendant dix-huit mois, ratifiant de fait sa prérogative de décider ce qui constituait une guerre. Lorsque certains membres tentèrent de porter l'affaire devant les tribunaux, ces derniers refusèrent , la qualifiant de « question politique » hors de leur compétence.
À Grenade, Reagan a orchestré une invasion surprise. Lorsque le Congrès a finalement protesté, le régime était tombé et les poursuites judiciaires ont été jugées sans objet. La résolution sur les pouvoirs de guerre ressemblait moins à une contrainte qu'à une simple formalité a posteriori .
La crise libyenne a confirmé cette tendance. Après les frappes aériennes américaines sur Tripoli et Benghazi en 1986, Reagan a scrupuleusement transmis des rapports au Congrès. Mais il a employé une formule soigneusement étudiée, insistant sur le fait que ces actions avaient été menées « conformément » à la loi sur les pouvoirs de guerre, et non « en application » de celle-ci. Cette tournure juridique a porté un coup fatal à la Constitution : elle signifiait que le Congrès serait tenu informé, mais pas nécessairement soumis à son autorité.
Au Nicaragua, lorsque le Congrès tenta de couper les vivres aux Contras par le biais des amendements Boland, le colonel North eut recours à des voies détournées. Les auditions Iran-Contra mirent au jour ces manœuvres et engendrèrent une leçon amère : même lorsque le Congrès agit directement, un président peut considérer ses lois comme des obstacles à contourner .
À la fin des années 1980, Reagan avait ordonné à la Marine de faire battre pavillon koweïtien sur des pétroliers américains pendant la guerre Iran-Irak, ce qui avait entraîné des échanges de tirs entre navires de guerre américains et iraniens. La plus grande bataille navale américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, l'opération Praying Mantis en 1988, fut présentée comme une « mission d'escorte », et non comme une guerre. Le Congrès garda le silence. Les tribunaux, une fois de plus, détournèrent le regard .
Ce que Reagan a fait concrètement a été renforcé par ce que la Cour suprême a fait en parallèle.
Dans l'affaire Dames & Moore c. Reagan (1981), la Cour a validé l'accord conclu entre Carter et Reagan pour mettre fin à la crise des otages en Iran, en suspendant les poursuites privées contre Téhéran et en transférant des milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés devant un tribunal international. Le Congrès n'avait jamais explicitement autorisé ces manœuvres. Conformément à l'arrêt Youngstown , le président aurait dû se trouver dans une situation extrêmement délicate. Au lieu de cela, les juges ont interprété le silence du Congrès comme un consentement, transformant ainsi la zone de danger définie par l'arrêt Jackson en un havre de paix.
L'année suivante, dans l'affaire Nixon contre Fitzgerald , la Cour suprême a déclaré les présidents immunisés de manière absolue contre les poursuites civiles pour actes officiels, non pas en raison d'une loi du Congrès, mais parce que le principe de séparation des pouvoirs l'exigeait. L'arrêt Youngstown portait sur les limites du pouvoir. L'arrêt Fitzgerald, quant à lui, concernait la responsabilité. En assimilant le silence à un consentement dans une affaire et en instaurant une immunité générale dans l'autre, la Cour a affaibli simultanément ces deux garde-fous.
Au moment où Reagan quitta ses fonctions, les contraintes imposées à Youngstown étaient toujours présentes, mais assouplies. La résolution sur les pouvoirs de guerre restait en vigueur, mais le pouvoir exécutif avait appris à la contourner : agir vite, rebaptiser le terme « combat », considérer l’obéissance comme une simple courtoisie et compter sur l’indifférence des tribunaux.
C’était le même genre de subterfuge habile que celui utilisé par le ministère de la Justice dans mon cas, lorsqu’il a redéfini un conflit relatif au Premier Amendement comme autre chose.
Reagan n'a pas orchestré de révolution constitutionnelle. Il n'en avait pas besoin. La pratique et la jurisprudence évoluaient de concert, au gré des manœuvres d'évitement. Le Congrès a acquiescé. Les tribunaux ont réinterprété les décisions ou ont détourné le regard.
J'ai suivi le déroulement des événements et je me suis dit : voilà comment ça se passe. À chaque fois, la laisse se desserre, mais elle ne se rompt jamais, et le pouvoir discrétionnaire du président s'accroît petit à petit.
Bush I – la présidence du fait accompli
George H.W. Bush a hérité de la stratégie de Reagan et l'a développée.
Panama (1989). Les troupes américaines envahissent le pays pour renverser Manuel Noriega sans autorisation. Le Congrès, face à une situation déjà réglée , ne peut que se plaindre mollement après coup.
Irak (1990-1991). Alors que les forces américaines se massaient pour l'opération Tempête du désert, cinquante-quatre parlementaires ont intenté une action en justice pour mettre fin à la guerre. Dans l'affaire Dellums contre Bush (1990), la Cour suprême a refusé d'intervenir, jugeant l'affaire prématurée. Ce n'est que lorsque la guerre est devenue imminente que le Congrès a adopté de justesse une autorisation , le président ayant forcé la décision.
Entre-temps, le pouvoir judiciaire a étendu l'immunité présidentielle au-delà des pouvoirs de guerre. Dans l'affaire Franklin c. Massachusetts (1992), la Cour suprême a jugé que le président n'était pas une « agence » au sens de la loi sur la procédure administrative, soustrayant ainsi de fait les décisions présidentielles à tout contrôle judiciaire. Et dans l'affaire Sale c. Haitian Centers Council (1993), la Cour a validé l'interdiction unilatérale et le renvoi de réfugiés haïtiens en mer.
Sur le moment, ces décisions semblaient mineures. Rétrospectivement, elles apparaissent comme d'inquiétantes préfigurations des années Trump, où les revendications d'immunité et les pouvoirs étendus en matière de frontières allaient ressurgir sous une forme bien plus agressive. Si l'arrêt Youngstown avait mis en garde contre un pouvoir exécutif sans contrôle, ces décisions ont montré comment les tribunaux dérivaient vers une conception de la présidence comme un domaine spécial et protégé .
Clinton – la présidence en zone grise.
Bill Clinton n'a jamais proclamé de théorie radicale de la suprématie de l'exécutif comme Richard Nixon. Il n'a pas non plus dissimulé ses manœuvres derrière le discours de Reagan sur les impératifs de sécurité nationale.
Pourtant, durant ses deux mandats, Clinton nous a montré à quel point un président pouvait accomplir beaucoup en exploitant les zones grises où la loi est ambiguë, le Congrès divisé et le pouvoir judiciaire réticent à arbitrer. Sa présidence est devenue une étude de cas sur l'expansion discrète des prérogatives par une improvisation constante.
La politique étrangère en a été le terrain d'expérimentation le plus évident. Clinton a hérité des troupes américaines en Somalie et les y a maintenues, même lorsque leur mission a dévié de l'aide humanitaire vers la confrontation armée. L'opération « Black Hawk Down » d'octobre 1993 a clairement démontré que l'Amérique était en guerre de facto, sans mandat du Congrès. Le retrait n'est intervenu qu'après l'indignation publique, et non suite à une intervention législative.
Le même scénario s'est répété en Haïti l'année suivante. Clinton a préparé une invasion pour renverser la junte au pouvoir, déployant 20 000 soldats avant que l'ancien président Carter ne négocie un retrait honorable. Les combats cessèrent, mais les troupes restèrent, cette fois en tant que force de maintien de la paix non autorisée, stabilisant l'île sans vote d'approbation du Congrès.
En Bosnie, Clinton ordonna des frappes aériennes de l'OTAN contre les forces serbes, malgré ses protestations au Congrès selon lesquelles il avait outrepassé ses pouvoirs. Le Kosovo fut l'apogée. En 1999, il lança une campagne de bombardements de soixante-dix-huit jours contre la Serbie après que la Chambre des représentants eut voté contre l'autorisation de la guerre. Un groupe bipartisan de parlementaires porta l'affaire devant les tribunaux. Ces derniers se désolidarisèrent de l'affaire, la qualifiant de « question politique ». Il en résulta un bouleversement : un président pouvait désormais défier ouvertement le Congrès en matière de déclaration de guerre sans encourir de conséquences juridiques immédiates.
Le Kosovo fut l'un des exemples les plus flagrants, depuis Youngstown, d'un président flirtant avec les limites de la légitimité constitutionnelle et s'en tirant impunément.
Sur le plan intérieur, Clinton se montra plus prudent, mais continua de tester les limites. Les Républicains contrôlant le Congrès pendant une grande partie de son mandat, il eut de plus en plus recours aux décrets présidentiels et à des interprétations créatives des lois pour faire avancer sa politique environnementale, sociale et de discrimination positive. Ses détracteurs l'accusaient de gouverner par décret, mais les batailles restèrent politiques plutôt que judiciaires. Cela prouvait que la « présidence administrative » n'était plus le monopole de la droite.
Le grand combat constitutionnelCette mesure est apparue avec la loi de 1996 sur le droit de veto partiel. Le Congrès, soucieux de renforcer son image de défenseur de la rigueur budgétaire, a conféré au président le pouvoir de supprimer des lignes budgétaires individuelles dans les lois omnibus. Clinton s'en est servi avec empressement, annulant un à un les allégements fiscaux et les projets clientélistes.
Mais les inévitables poursuites judiciaires ont abouti à l' affaire Clinton contre la ville de New York (1998), où la Cour suprême a invalidé la loi pour violation de la clause de présentation – l'exigence constitutionnelle selon laquelle un projet de loi doit être adopté ou rejeté dans son intégralité, et non modifié a posteriori. En permettant à Clinton de réécrire des lois dûment promulguées, a déclaré la Cour, le Congrès avait abandonné une trop grande partie de son pouvoir législatif fondamental.
Parallèlement, dans l' affaire Clinton contre Jones (1997), les juges ont rejeté à l'unanimité sa demande d'immunité temporaire contre les poursuites civiles pour des actes antérieurs à sa présidence. Cette décision a ouvert la voie à la plainte pour harcèlement sexuel de Paula Jones et, indirectement, à l'enchaînement d'événements qui ont conduit à la destitution de Clinton. La Cour a été catégorique : le président n'est pas au-dessus des lois en tant qu'acteur privé .
En définitive, les tribunaux de l'ère Clinton se sont montrés plus sévères envers les abus de pouvoir de l'exécutif sur le plan intérieur que sur le plan de la politique étrangère. À l'étranger, ils ont esquivé et tergiversé, laissant au président la latitude de contourner la résolution sur les pouvoirs de guerre. Sur le plan intérieur, ils ont établi des lignes plus nettes lorsque des limites légales ou l'immunité personnelle étaient en jeu.
Clinton, pour sa part, n'a jamais revendiqué l'autorité d'un « exécutif unitaire » ni de pouvoirs de guerre inhérents. Pourtant, en considérant la résolution sur les pouvoirs de guerre comme facultative, en lançant une importante campagne de bombardements après un vote du Congrès contre cette résolution, et en recourant à des mécanismes de contournement législatifs comme le droit de veto partiel, il a élargi le champ de l'initiative présidentielle. Il a démontré aux futurs présidents qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une théorie pour étendre les pouvoirs de la fonction, mais simplement la volonté d'exploiter les zones grises que d'autres laissent de côté.
George W. Bush – De la zone grise au chèque en blanc.
Si Clinton a normalisé l'improvisation dans les zones grises du droit, George W. Bush l'a érigée en doctrine inflexible. Les attentats du 11 septembre lui ont offert ce que Clinton n'avait jamais eu : un Congrès et une opinion publique prêts à lui accorder une latitude considérable, et une armée de juristes au sein du Bureau du conseiller juridique, désireux de présenter le président comme quasiment intouchable en temps de guerre.
Quelques jours après le 11 septembre, le Congrès a adopté l'autorisation d'utiliser la force militaire (AUMF) du 18 septembre 2001. Son libellé était d'une portée stupéfiante, autorisant le président à utiliser « toute la force nécessaire et appropriée » contre ceux qu'il jugeait responsables d'avoir « planifié, autorisé, commis ou aidé » les attentats.
Ce qui devait être une réponse rapide à une catastrophe ponctuelle est vite devenu le cadre juridique d'une guerre mondiale sans fin contre un ennemi idéologique mouvant. L'invasion de l'Afghanistan, la traque des affiliés d'Al-Qaïda sur plusieurs continents, les campagnes secrètes de drones et les assassinats ciblés découlaient tous de cette simple phrase.
Bush a obtenu une autorisation distincte pour l'Irak en 2002, mais même ce vote minimisait l'argument plus large de l'administration : le président pouvait frapper préventivement partout où il percevait un danger. L'absence d'armes de destruction massive n'a en rien atténué ce précédent. La guerre préventive était désormais intégrée à l'arsenal du commandant en chef.
Sur le plan intérieur, cette même logique d'urgence permanente a conduit à un élargissement spectaculaire des pouvoirs exécutifs. L'administration a créé un véritable archipel de centres de détention , de Guantánamo aux « sites noirs » de la CIA, en se fondant sur l'affirmation que les pouvoirs en temps de guerre n'étaient pas limités par les lois ordinaires ni par les protections constitutionnelles. Les « techniques d'interrogatoire renforcées », les extraditions extraordinaires et la détention indéfinie de « combattants ennemis » reposaient sur cette théorie de la nécessité extralégale.
Le programme d'écoutes téléphoniques sans mandat de la NSA a étendu ce cadre à la surveillance intérieure, contournant la loi sur la surveillance du renseignement étranger (FISA) au nom de l'autorité présidentielle inhérente. Par ailleurs, le recours sans précédent de Bush aux déclarations sous serment – plus de 1 000 – témoignait d'une propension systématique à ignorer ou à réinterpréter les lois qu'il jugeait empiétant sur le pouvoir exécutif. C'était la théorie de l'exécutif unitaire, passée du domaine académique à la pratique opérationnelle.
Contrairement à l'intervention de Clinton au Kosovo, la Cour suprême a tenté de freiner les ardeurs de l'exécutif, en rendant une série de décisions réaffirmant les limites de son initiative, même en temps de guerre.
Le fil conducteur n'était pas tant un sentiment pacifiste ou une compassion pour les détenus qu'une volonté d'autodéfense institutionnelle : l'administration Bush, forte des théories radicales de l'exécutif unitaire défendues par des juristes du Bureau du conseiller juridique (OLC) comme John Yoo et David Addington, considérait que les tribunaux n'avaient aucun rôle significatif à jouer. Les juges, au-delà des clivages idéologiques, ont résisté à toute revendication visant à les exclure de facto de la Constitution. Lorsque la Maison-Blanche a revendiqué un pouvoir de commandant en chef si étendu qu'il supprimait tout contrôle judiciaire, la Cour a riposté pour préserver son rôle constitutionnel au sein du système judiciaire.
Donc :
Hamdi c. Rumsfeld (2004) : La Cour a déclaré que les citoyens américains détenus en tant que combattants ennemis avaient le droit de contester leur détention devant un décideur neutre, rejetant la prétention de l'administration à une autorité sans contrôle.
Rasul c. Bush (2004) : Les détenus de Guantánamo ont été autorisés à déposer des requêtes d'habeas corpus devant un tribunal fédéral, bien qu'ils soient détenus en dehors du territoire souverain des États-Unis.
Hamdan c. Rumsfeld (2006) : La Cour a invalidé les commissions militaires créées par Bush, estimant qu'elles violaient à la fois le Code uniforme de justice militaire et les Conventions de Genève.
Boumediene c. Bush (2008) : La Cour a étendu les droits d’habeas corpus aux détenus de Guantánamo même après que le Congrès ait tenté de lui retirer sa compétence .
Ces décisions ont collectivement réaffirmé le principe du contrôle judiciaire, mais elles sont intervenues des années après le début de la « guerre contre le terrorisme », alors que la nouvelle architecture de l’action unilatérale était déjà en place.
Quoi qu’on pense de Bush, il a profondément transformé la présidence . Les précédentes interventions unilatérales – Truman en Corée, Reagan à Grenade, Clinton au Kosovo – étaient limitées par la géographie ou la durée. Bush a brisé ce moule. En définissant le conflit avec Al-Qaïda comme mondial, sans frontières et potentiellement sans fin, il a créé le premier champ de bataille véritablement ouvert de l’histoire présidentielle moderne.
L'AUMF, sans limites géographiques ni clause d'extinction, est devenue une autorisation illimitée d'utiliser la force, une délégation de pouvoir plus étendue que tout ce que le Congrès avait accordé depuis la Seconde Guerre mondiale.
L’innovation la plus marquante fut sans doute la fusion des pouvoirs de guerre étrangers et de la gouvernance des situations d’urgence intérieures. Opérations létales à l’étranger, surveillance sans mandat sur le territoire national, systèmes de détention improvisés et recours systématique aux prérogatives du commandant en chef découlaient tous d’une même affirmation : la crise exigeait une déférence judiciaire et un pouvoir discrétionnaire présidentiel accru.
Les réformes post-Watergate visaient précisément à empêcher cette concentration des pouvoirs. La « guerre contre le terrorisme » l’a pérennisée, démontrant comment le discours de crise pouvait servir à justifier des pouvoirs bien supérieurs à ceux explicitement conférés par le Congrès.
Donald Trump ne tarderait pas à s'en apercevoir.
Dès lors que le champ de bataille s'étend à tout le monde, le contrôle passe au second plan. Et lorsque la présidence comprend qu'une action unilatérale peut se justifier sans limites temporelles ni géographiques claires, la tentation d'utiliser ces outils devient inhérente à la fonction.
Barack Obama – normaliser l'état d'urgence
Obama a fait campagne en se présentant comme l'anti-Bush, un constitutionnaliste promettant de rétablir l'équilibre des pouvoirs après les abus de la « guerre contre le terrorisme ». Mais une fois au pouvoir, il a découvert que les pouvoirs revendiqués par Bush étaient non seulement difficiles à abandonner, mais aussi politiquement irrésistibles.
Alors que Bush avait étendu les pouvoirs exécutifs sous couvert d'état d'urgence, Obama a institutionnalisé ces pouvoirs implicites, les enveloppant de procédures légales et d'une rhétorique libérale.
Résultat : la continuité déguisée en réforme.
Un paradoxe ? Sans aucun doute. La politique étrangère d'Obama en était un parfait exemple . Il avait promis de fermer Guantánamo, mais l'a laissé ouvert. Il avait promis de mettre fin aux guerres, mais en a étendu le champ d'action, parfois à distance, souvent en modifiant légèrement la version officielle.
Voici un aperçu de son esprit d'aventurier décontracté.
Frappes de drones : Obama a considérablement accéléré l’utilisation de drones au Pakistan, au Yémen et en Somalie, autorisant des assassinats ciblés, notamment la frappe qui a tué le citoyen américain Anwar al-Awlaki en 2011, sans approbation judiciaire ni contrôle du Congrès. La Maison-Blanche a justifié ces assassinats par des notes secrètes du Bureau du conseiller juridique (OLC ), affirmant qu’une procédure régulière pouvait être respectée par un examen interne de l’exécutif.
Intervention en Libye (2011): Lorsque l’OTAN a lancé des frappes aériennes pour renverser Mouammar Kadhafi, Obama a refusé de solliciter l’autorisation du Congrès. Ses juristes ont plaidé que l’opération ne constituait pas un acte d’« hostilités » au sens de la loi sur les pouvoirs de guerre, car les forces américaines ne couraient que peu de risques de pertes. Cette manœuvre sémantique a suscité des critiques bipartisanes, mais n’a donné lieu à aucune contestation judiciaire fructueuse.
Continuité de l'AUMF: Obama s'est appuyé à plusieurs reprises sur l'AUMF de 2001 de Bush pour autoriser des frappes contre des groupes très éloignés d'Al-Qaïda, y compris l'EI, qui n'existait même pas en 2001. Il en a résulté un état de guerre sans limite géographique ni temporelle.
Sur le plan intérieur, Obama s'est montré plus mesuré que Bush, mais a tout de même eu largement recours aux outils exécutifs face à l'impasse au Congrès.
Voici à nouveau quelques exemples :
Programme d'action différée pour les arrivées d'enfants (DACA, 2012) : Faute d'avoir obtenu une réforme de l'immigration par le Congrès, Obama a eu recours à un décret présidentiel pour protéger les jeunes sans-papiers de l'expulsion. Il a justifié cette mesure comme un exercice du pouvoir discrétionnaire du procureur, tandis que ses détracteurs y voyaient une réécriture inconstitutionnelle du droit de l'immigration.
Réglementation environnementale : L’Agence de protection de l’environnement (EPA) d’Obama a mis en œuvre des politiques climatiques ambitieuses par le biais de réglementations, culminant avec le Clean Power Plan. Une fois de plus, ses opposants l’ ont accusé de contourner le Congrès. La Cour suprême a par la suite suspendu l’application de ces mesures, laissant présager de futures restrictions.
Ces manœuvres reflétaient l'opinion d'Obama selon laquelle la présidence pouvait agir unilatéralement en matière d'affaires intérieures lorsque le Congrès refusait d'agir .
Durant ses deux mandats, la Cour suprême a parfois restreint la marge de manœuvre du président, mais dans certains litiges très médiatisés, elle a donné son approbation.
Des performances remarquables, des deux côtés du bilan :
Utility Air Regulatory Group c. EPA (2014) : La Cour a limité la portée des réglementations de l'EPA sur les gaz à effet de serre, soulignant que même des problèmes urgents comme le changement climatique ne pouvaient pas justifier une réinterprétation exécutive sans limites.
NLRB c. Noel Canning (2014) : La Cour a statué à l'unanimité que les nominations d'Obama pendant les vacances parlementaires étaient inconstitutionnelles, une réprimande aux interprétations exécutives extensives des pouvoirs procéduraux.
Zivotofsky c. Kerry (2015): Dans une affaire concernant des passeports mentionnant « Jérusalem, Israël », la Cour a donné raison à Obama, confirmant l’autorité exclusive du président pour reconnaître les souverainetés étrangères. Cette décision a renforcé les prérogatives de l’exécutif en matière de politique étrangère.
En résumé : si la Cour a affirmé une forte primauté présidentielle en matière de politique étrangère, elle a généralement limité l'improvisation de l'exécutif sur le plan intérieur.
Quel a donc été le rôle global d'Obama dans le renforcement du pouvoir présidentiel ?
Certes, il n'a pas brandi la théorie d'un « exécutif unitaire » comme l'avaient fait Reagan et les Bush. Il n'a pas non plus improvisé avec autant d'audace que Clinton.
Au lieu de cela, il a bâti un édifice juridique autour de pouvoirs hérités.
Lorsqu'un constitutionnaliste considère les frappes de drones et la guerre perpétuelle comme une pratique courante, l'extraordinaire devient ordinaire.
En réalité, Obama a conféré une légitimité bipartite aux mesures inédites de Bush.
Et Youngstown ?
Au moment où Obama a pris ses fonctions, les garde-fous constitutionnels établis par l'arrêt Youngstown limitant les abus de pouvoir présidentiels étaient déjà fortement affaiblis. Il a apporté une sorte de vernis constitutionnel , une manière de banaliser , voire de légitimer, l'exercice d'un pouvoir exceptionnel. S'il n'a pas enrayé l'érosion des limites instaurées par le juge Jackson, il les a au moins atténuées.
La présidence est ressortie de son mandat plus souple , plus protégée des contraintes du Congrès et plus confiante dans la possibilité d'assouplir les normes constitutionnelles sans donner l'impression de les enfreindre.
Ainsi, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir en promettant un maximalisme « L’Amérique d’abord », il a hérité d’une présidence déjà conditionnée à agir unilatéralement à l’étranger et à s’appuyer sur des décrets présidentiels au niveau national lorsque le Congrès rechignait.
Obama avait démontré qu'un président impérial pouvait gouverner discrètement et avec douceur, à l'aide de notes juridiques et de décrets. Trump, quant à lui, utiliserait ces mêmes instruments de manière bruyante, hasardeuse et souvent cruelle, dans le seul but d'obtenir un effet politique pur.
Trump 1.0 — Un maximalisme assumé, à peine contenu
Le premier mandat de DJT a révélé l'étendue de la marge de manœuvre que lui avaient léguée ses prédécesseurs. Les manœuvres dilatoires de Reagan, les improvisations de Clinton, les doctrines de guerre de George W. Bush et les améliorations juridiques d'Obama avaient toutes contribué à enrichir l'arsenal du pouvoir exécutif. Trump s'est simplement emparé des outils déjà à sa disposition et les a utilisés sans vergogne, souvent sans même feindre la modestie constitutionnelle.
Il considérait l'autorité présidentielle non comme un pouvoir à contrebalancer face au Congrès ou aux tribunaux, mais comme un instrument de domination. Les garde-fous de Youngstown Ces obstacles ne représentaient plus pour lui que de simples ralentisseurs. Le juge Jackson avait averti qu'un président agit au plus bas de sa forme lorsqu'il défie le Congrès. Trump semblait trouver cette situation exaltante.
Les premiers critiques, comme moi, n'exagéraient pas lorsqu'ils le dénonçaient comme un tyran en puissance. Les prémices étaient déjà présentes. Et elles se sont rapidement propagées.
De son refus de se désengager de ses entreprises en violation de la clause sur les émoluments à son utilisation du ministère de la Justice comme bouclier personnel, Trump a à plusieurs reprises outrepassé ou brouillé la frontière entre devoir public et intérêt privé.
L’« urgence » de 2019 concernant le mur frontalier illustre parfaitement les abus de pouvoir de Trump. Cette crise avait été orchestrée de manière politique pour débloquer des fonds pour le Pentagone, fonds que le Congrès avait refusé d’allouer. Lorsque les deux chambres, y compris une douzaine de républicains, ont voté pour mettre fin à l’urgence, Trump a tout simplement opposé son veto, défiant le Congrès de passer outre.
La Cour suprême, recourant à sa procédure parallèle (un mécanisme accéléré pour les décisions d'urgence, dont mon cas avait été une illustration), a autorisé le transfert de fonds. C'était un renversement presque parfait de l'arrêt Youngstown . Alors que Truman s'était vu interdire de réquisitionner des aciéries en temps de guerre, Trump a bénéficié d'une tolérance pour avoir saisi des fonds que le Congrès avait explicitement refusé de débloquer.
En matière de politique étrangère, il a fait preuve du même mépris pour les limites légales. Il a ordonné des frappes de missiles en Syrie sans l'approbation du Congrès et a ensuite ordonné l'assassinat du commandant iranien Qassem Soleimani. Ces deux actes ont poussé la guerre unilatérale à ses limites. Lorsque les parlementaires ont invoqué la résolution sur les pouvoirs de guerre, Trump a opposé son veto à leur demande de limiter son pouvoir.
C'est exact. J'y ai opposé mon veto .
Tant en matière de politique étrangère qu'intérieure, il préférait agir en premier et laisser aux constitutionnalistes le soin de gérer les conséquences. Les tribunaux se sont souvent pliés à ses exigences. Dans l' affaire Trump contre Hawaï (2018), les juges ont validé son décret interdisant l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane, reconnaissant ainsi le pouvoir discrétionnaire du président en matière d'immigration et de sécurité nationale. Dans l'affaire Seila Law contre le CFPB (2020), ils ont restreint la capacité du Congrès à soustraire les organismes de réglementation au contrôle présidentiel.
À maintes reprises, la prudence du pouvoir judiciaire s'est transformée en complicité , accordant à Trump ce qui revenait à une tolérance anticipée pour ses excès.
Le Congrès, quant à lui, n'a réagi que sporadiquement. Le contrôle s'est exercé par à-coups. La première procédure de destitution, fondée sur des pressions présumées exercées par Trump sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur un rival politique, a révélé son mépris des limites constitutionnelles. La seconde, après le 6 janvier, a confirmé la vacuité de ces limites. À deux reprises, le Congrès a eu recours à la procédure de destitution, et à deux reprises, il a reculé au dernier moment, le Sénat ne votant jamais pour la condamnation. Ces deux acquittements ont démontré à tous les futurs présidents que la destitution était une chimère. Le principe de Youngstown , qui prévoyait un équilibre des pouvoirs, était devenu une relique des manuels d'instruction civique, respectée surtout lorsqu'elle était bafouée.
Pourtant, la volonté de Trump d'instaurer un pouvoir impérial n'est pas restée totalement sans opposition. Pendant un temps, quelques traditionalistes ont résisté.
Le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, s'est opposé à l'« urgence » instaurée pour le mur frontalier et a démissionné après que Trump a ordonné un retrait précipité de Syrie, avertissant qu'abandonner ses alliés constituait une trahison de l'honneur américain. Le conseiller à la sécurité nationale, H.R. McMaster, a lutté pour préserver l'unité de l'OTAN face à la tendance isolationniste du président. Quant au conseiller juridique de la Maison-Blanche, Don McGahn, il a discrètement bloqué les tentatives d'instrumentaliser le ministère de la Justice, allant jusqu'à menacer de démissionner plutôt que de limoger le procureur spécial Mueller.
Même John Bolton, pourtant loin d'être un pacifiste, a refusé de cautionner la tentative de Trump d'échanger l'aide étrangère contre des faveurs politiques.
Ces arbitres improbables représentaient la fine ligne grise entre l'imprudence et l'effondrement.
Mais à mesure qu'ils partaient un à un, la loyauté l'emporta sur la dissidence. Les remparts institutionnels qui avaient protégé la République de son propre chef de l'exécutif commencèrent à s'effriter. La présidence ne fonctionnait plus comme un pouvoir égal à celui des autres pouvoirs de l'État, mais comme le domaine privé d'un seul homme et de ses griefs, entretenu par l'acquiescement du pouvoir judiciaire et la lassitude du Congrès.
À la mi-2020, alors que la campagne électorale s'intensifiait et que la pandémie mettait en lumière toutes les failles du régime Trump, de nombreux électeurs étaient mécontents de ce qu'ils voyaient. Non seulement il avait outrepassé les limites légales, mais il avait délibérément et systématiquement remis en question leur applicabilité à sa situation.
Son refus d'accepter les résultats des élections, ses intimidations envers les responsables de l'État et sa complicité dans l'assaut du Capitole le 6 janvier semblaient être l'aboutissement d'une présidence convaincue que la légalité était réservée aux faibles.
Nixon a dit un jour : « Quand le président le fait, cela signifie que ce n'est pas illégal. » Trump a vécu selon ce principe sans la moindre ironie.
Son style de gouvernement était si inédit, si singulier , que nombre d'entre nous en vinrent à envisager ce qui relevait autrefois de la fiction : l'idée troublante qu'un président puisse être à ce point déconnecté de l'ADN civique de la nation qu'il confonde loyauté envers lui-même et loyauté envers la République. Ce n'était pas seulement le risque d'espionnage ou d'ingérence étrangère qui nous inquiétait ; c'était la question même de l'allégeance : avec quelle facilité Trump semblait s'identifier à ceux qui voulaient du mal à l'Amérique.
Cette mentalité s'est avérée plus révélatrice que n'importe quelle politique prise individuellement. Trump concevait le pouvoir comme une transaction, non comme une relation de confiance. Alliances, lois, voire loyautés nationales, n'étaient pour lui que des instruments négociables, utiles uniquement tant qu'ils servaient ses intérêts personnels. Cette psychologie a effacé la frontière entre intérêt personnel et art de gouverner, donnant lieu à des gestes qu'aucun président moderne n'avait osé entreprendre.
Durant sa campagne de 2016, il avait invité Moscou à « retrouver » les courriels d'Hillary Clinton et s'était fortement appuyé sur un conseiller politique dont le collaborateur s'est avéré être un espion russe, selon les enquêteurs du Sénat. Deux ans plus tard, il s'est prosterné aux pieds de Poutine lors du sommet d'Helsinki, prenant publiquement parti pour le déni du dictateur concernant toute ingérence électorale, au détriment des conclusions de nos propres services de renseignement.
À maintes reprises, Trump a qualifié l'OTAN d'« obsolète », a dénigré les dirigeants alliés et a encensé les autocrates qui le flattaient. Entre ses mains, l'ordre d'après-guerre n'était plus qu'un accord de plus à réécrire.
Il en résulta un renversement des rôles moraux : l’admiration pour les hommes forts, la méfiance envers les alliés et une redéfinition du patriotisme lui-même comme une fidélité personnelle envers lui.
Le premier mandat de Trump nous a tous contraints à envisager une possibilité longtemps considérée comme purement théorique : celle que le système de freins et contrepoids de la Constitution ne soit pas infaillible. Ses prédécesseurs, au moins, reconnaissaient l’existence des procédures légales. Trump, lui, les a traitées comme une simple mise en scène, un spectacle à jouer puis à ignorer. Il a démontré avec quelle facilité un président déterminé pouvait bouleverser un système démocratique, simplement en refusant d’admettre sa responsabilité.
La surprise n'était pas qu'il ait essayé, mais qu'il s'en soit tiré la plupart du temps sans problème.
Il a quitté ses fonctions vaincu mais sans remords. Sa présidence avait transformé des décennies d'expansion progressive du pouvoir exécutif en quelque chose de nouveau : un maximalisme assumé, tempéré seulement par une poignée d'adultes débordés et quelques faux pas institutionnels occasionnels.
Cet équilibre précaire ne survivrait pas à son retour.
Point d'inflexion – la Cour remodelée à l'image de Trump
L'un des événements les plus lourds de conséquences politiques du premier mandat de Trump n'était que partiellement de son fait. Il ne résultait ni d'un meeting ni d'un tweet nocturne, mais d'une conjonction de facteurs : le contexte, la gravité de la situation et des manœuvres au Sénat.
Tout ceci mérite qu'on s'y attarde avant de passer à la suite.
Trump n'a pas orchestré le vieillissement ni le décès des juges de la Cour suprême, mais il a profité de trois postes vacants en quatre ans, une situation inédite depuis Nixon. Ce qui a compté, ce n'est pas seulement la chance, mais la manière dont le chef de la majorité sénatoriale, Mitch McConnell, l'a exploitée.
Après le décès du juge Antonin Scalia début 2016, le président Obama, comme vous vous en souvenez, avait nommé Merrick Garland, un centriste jouissant d'un respect bipartisan. McConnell a refusé d'organiser une audition, inventant une règle interdisant la confirmation de juges en année électorale et bloquant ainsi la nomination pendant près de douze mois.
Une fois élu, Trump a nommé Neil Gorsuch. Pour assurer la confirmation, McConnell a supprimé la possibilité de faire obstruction aux nominations à la Cour suprême, abaissant ainsi le seuil à une simple majorité.
Lorsque le juge Anthony Kennedy a pris sa retraite en 2018, Brett Kavanaugh a été confirmé à une voix près. Et lorsque Ruth Bader Ginsburg est décédée six semaines avant l'élection de 2020, alors que les Américains votaient déjà, McConnell a renié sa propre « règle » de délibération préalable et a précipité la confirmation d'Amy Coney Barrett en à peine 30 jours.
Au moment où Trump a quitté la Maison Blanche, une supermajorité conservatrice de 6 contre 3 avait été consolidée à la Cour suprême, non seulement pour sa présidence, mais pour toute une génération.
Le premier mandat de Trump a démontré jusqu'où un président pouvait étendre son pouvoir. McConnell nous a montré comment ancrer ce pouvoir dans le système judiciaire, bien après que l'électorat se soit détourné de lui.
Ce qui suivit changea la donne. L'arrêt Roe v. Wade fut invalidé , l'indépendance des agences se réduisit et la Cour s'attela à élargir le champ du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif. C'était précisément le terrain que Trump avait déjà exploré à maintes reprises.
Joe Biden — Restauration et résidus
Joe Biden est entré à la Maison-Blanche en 2021 en promettant de réparer les dégâts constitutionnels et moraux que Trump lui avait infligés. Il a promis de rétablir l'équilibre, les normes et le respect des procédures.
Pourtant, même en s'efforçant de gouverner par la négociation, il se retrouva à dépendre de plus en plus des mêmes pouvoirs exécutifs que ses prédécesseurs avaient progressivement étendus pendant trois décennies. La présidence dont il hérita était déjà en pleine expansion. Son mandat démontra combien il est difficile d'inverser cette tendance.
Il a commencé de manière assez conventionnelle, en recherchant des accords bipartites — le plan de sauvetage, le projet de loi sur les infrastructures, la loi CHIPS — et en ravivant brièvement l'image d'un président législatif.
Mais à mesure que la polarisation s'accentuait, le Congrès se figeait et Biden recourait à des solutions unilatérales lui permettant de faire avancer la politique sans attendre d'autorisation.
En matière d'immigration, il a annulé les décrets les plus sévères de Trump, tout en promulguant de nouvelles mesures. Concernant le climat , il a décrété l'état d'urgence, suspendu les forages et réorienté des milliards de dollars vers la production d'énergie propre. Chaque initiative relevait du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif ; chacune a donné lieu à des poursuites judiciaires qui ont mis à l'épreuve les limites du pouvoir présidentiel.
À l'étranger, Biden a réaffirmé une vérité désormais bien connue concernant la présidence moderne : en matière de guerre et de diplomatie, les présidents agissent d'abord et expliquent ensuite. Son ordre de retrait complet d'Afghanistan a été présenté comme une décision du commandant en chef, définitive et unilatérale. Ce retrait chaotique a mis en lumière à la fois le pouvoir unilatéral du président de mettre fin à une guerre et l'incapacité du Congrès à la gérer.
Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, Biden a acheminé des dizaines de milliards de dollars d'armes et de renseignements grâce à un mélange de prérogatives légales et de contrôle de la Maison-Blanche. Et pendant le conflit de Gaza, il a approuvé à plusieurs reprises des transferts d'armes et protégé Israël aux Nations Unies, évoquant parfois des conditions, mais sans jamais renoncer à l'initiative. Les rouages de la politique étrangère, malgré la rhétorique du « partage des pouvoirs », sont restés confinés au pouvoir exécutif.
Aux États-Unis, la situation était différente. Le recours de Biden aux pouvoirs d'urgence et à la réglementation des agences s'est heurté à une Cour suprême de plus en plus conservatrice et désormais sceptique à l'égard de l'État administratif. Dans l'affaire West Virginia c. EPA (2022), les juges ont invoqué la « doctrine des questions majeures » pour encadrer les organismes de réglementation, avertissant que les politiques économiques d'envergure nécessitaient une approbation sans équivoque du Congrès. Dans l'affaire Biden c. Nebraska (2023), ils ont invalidé son plan d'annulation de la dette étudiante, statuant que la loi HEROES n'autorisait pas une mesure aussi radicale.
Même sa tentative de prolonger le moratoire sur les expulsions lié à la pandémie a été rejetée après que la Cour a indiqué que seul le Congrès pouvait imposer une interdiction à l'échelle nationale. À l'étranger, la déférence judiciaire a persisté. Aux États-Unis, les marges de manœuvre se sont réduites.
Ce qui s'est dégagé, c'est l'image d'une continuité déguisée en correction. La présidence de Biden a certes rétabli le décorum, mais a aussi confirmé que la « présidence impériale » était désormais une infrastructure bipartite. Le vocabulaire a changé. La consultation a remplacé la confrontation. Mais les instruments de l'action unilatérale ont perduré. Chaque crise a suscité le même réflexe : agir d'abord, intenter un procès ensuite.
L’héritage de Biden réside donc moins dans ce qu’il a inversé que dans ce qu’il a révélé : que la présidence américaine, autrefois contrainte par le Congrès et les précédents, fonctionne désormais selon des habitudes d’autorité trop ancrées pour être déconstruites.
Point d'inflexion – Trump contre les États-Unis
La dernière année du mandat de Biden a été marquée par une décision de la Cour suprême qui a redéfini les limites qu'il avait, avec d'autres, repoussées. Dans l' affaire Trump contre États-Unis (2024), la Cour a fait plus que simplement soustraire son prédécesseur à des poursuites : elle a redessiné le cadre de la responsabilité présidentielle.
L'avis du juge en chef John Roberts stipule qu'un président bénéficie d'une immunité absolue de responsabilité pénale pour les actes accomplis dans le cadre de son « autorité constitutionnelle exclusive », et d' une immunité présumée pour les autres « actes officiels ». Seuls les comportements « non officiels », les manœuvres personnelles ou politiques, échappent à son contrôle.
En clair : un président qui dissimule son comportement sous les attributs de sa fonction peut échapper à la justice pénale.
L'affaire trouve son origine dans les poursuites engagées par le procureur spécial Jack Smith contre Trump pour avoir prétendument tenté d'invalider l'élection de 2020. Les avocats de la défense ont plaidé que les pressions exercées sur les responsables des États et le recours aux voies officielles par l'accusé constituaient des « actes officiels » protégés de poursuites. Suite au rejet de cet argument par les juridictions inférieures, Trump a fait appel. La Cour suprême, sous la présidence de Biden, a accepté d'examiner la question de savoir si un ancien président pouvait être poursuivi pénalement pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Roberts a fondé son raisonnement non pas sur une clause constitutionnelle ou une loi, mais sur la « structure » de l’article II. Il a soutenu que la séparation des pouvoirs exige de protéger les présidents de toute poursuite judiciaire afin qu’ils puissent agir « sans crainte et avec impartialité ». Autrement, a-t-il averti, chaque décision controversée pourrait entraîner des poursuites une fois qu’ils auront quitté leurs fonctions.
Pour que cette protection fonctionne, il a établi une distinction nette entre ce qu'il a appelé les pouvoirs présidentiels « définitifs et exclusifs » — tels que l'octroi de grâces ou le commandement des forces armées — et ceux qui empiètent sur l'autorité du Congrès. Les actes de la première catégorie, a-t-il déclaré, échappent à toute autre branche du pouvoir. Tout le reste bénéficie d'une « présomption de protection » : les tribunaux doivent d'abord considérer les actes contestés comme immunisés et ne peuvent lever cette protection que dans des circonstances exceptionnelles.
C'était une formule ingénieuse aux effets considérables. En qualifiant certains pouvoirs d'« exclusifs », Roberts les a de fait soustraits à toute loi que le Congrès pourrait voter ou à toute décision de justice que les tribunaux pourraient appliquer.
Le changement fut d'ordre fonctionnel, non textuel. Il a transformé un principe politique, la nécessité d'un leadership exécutif fort, en une doctrine constitutionnelle d'immunité. À cet égard, l' arrêt Trump contre les États-Unis s'appuyait sur l' arrêt Nixon contre Fitzgerald (1982), qui accordait déjà aux présidents une immunité absolue contre les poursuites civiles liées à leurs actes officiels. Roberts a étendu ce raisonnement au domaine pénal, renforçant ainsi une protection initialement établie quarante ans plus tôt.
Cette manœuvre rappelait la tactique employée par la Cour dans ma propre affaire, où un litige relatif au Premier Amendement avait été requalifié en question contractuelle afin d'échapper à un examen constitutionnel. Dans cette affaire, la liberté d'expression s'était évanouie au profit d'un simple détail technique. Ici, la responsabilité pénale s'était dissoute dans la notion de « structure ».
Contre toute attente, Roberts invoqua l' arrêt Youngstown et cita même Jackson, affirmant que le pouvoir présidentiel devait émaner soit d'une loi du Congrès, soit de la Constitution elle-même. Mais il s'en servit non pour définir des limites, comme l'avait prévu Jackson, mais pour ériger une forteresse. Si l' arrêt Youngstown marquait la frontière du pouvoir exécutif, l'arrêt Trump contre les États-Unis la redéfinit en tant que territoire souverain.
Et le Congrès , de façon flagrante, était aux abonnés absents . L'arrêt Youngstown avait été le théâtre d'un affrontement entre les pouvoirs législatif et exécutif. L'arrêt Trump contre les États-Unis a apaisé ces tensions. En considérant l'immunité comme une nécessité constitutionnelle plutôt que comme une question de droit, Roberts n'a laissé aucune marge de manœuvre aux législateurs, ni même aux tribunaux futurs, pour en définir les limites.
Pour Donald Trump, la décision de justice a constitué un sursis immédiat. Des pans entiers de l'acte d'accusation du procureur spécial Jack Smith, notamment ceux relatifs aux communications officielles postérieures à l'élection de 2020, ont dû être réexaminés à la lumière de cette nouvelle interprétation. Pour la présidence elle-même, les implications sont plus profondes. La Cour a de facto instauré un système juridique à deux vitesses: l'un pour les citoyens, l'autre pour les présidents agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
Les critiques dénoncent le renversement de la « force » de l'exécutif. Ce qu'Alexander Hamilton célébrait comme une vigueur nécessaire à la présidence est devenu un rempart contre toute responsabilité. Un exécutif qui sait qu'il ne peut être poursuivi pour ses « actes officiels » risque d'agir moins avec courage qu'avec imprudence.
Il y a soixante-dix ans, l'arrêt Youngstown consacrait le principe selon lequel le pouvoir présidentiel est le plus faible lorsqu'il défie le Congrès. L'avis du juge Roberts dans l'affaire Trump contre États-Unis renverse cette logique : lorsqu'un président s'arroge des prérogatives constitutionnelles, son pouvoir – et désormais son immunité – atteignent leur apogée.
La Cour n'a pas rejeté l'arrêt Youngstown , mais l'a adapté à son contexte. À en juger par le sous-texte de Roberts, la présidence moderne est moins un pouvoir égalitaire qu'un pouvoir souverain, doté de son propre champ de force juridique.
Point de bascule – Les orientations de la Heritage Foundation et la voie rapide vers un second mandat de Trump . L’arrêt de la Cour suprême dans l’ affaire Trump contre États-Unis a confirmé l’ampleur de la redéfinition du pouvoir présidentiel. Ce changement, mûri de longue date, trouve son origine dans l’establishment juridique conservateur de Washington, la Federalist Society et surtout la Heritage Foundation, qui, depuis 1973, fait office de laboratoire d’idées et de vivier de talents pour la droite . Lorsque Trump a eu besoin de rassurer les conservateurs en 2016, la Heritage Foundation lui a fourni une liste restreinte de candidats acceptables pour la Cour suprême. Gorsuch y figurait. Sa nomination, suivie de celles de Kavanaugh et Barrett, a consolidé une supermajorité conservatrice largement alignée sur le programme de la Heritage Foundation. Deux juges en exercice, Samuel Alito et Clarence Thomas, évoluaient déjà confortablement dans la sphère idéologique de la Heritage Foundation. Alito a rédigé la préface d’une de ses publications. Thomas a participé à des séminaires pour donateurs et à des événements privés. Ces relations, bien qu’informelles, étaient mutuellement avantageuses. La Heritage Foundation affinait les concepts et la Cour leur apportait une validation constitutionnelle. À mi-mandat de la présidence Biden, la Heritage Foundation a mis en œuvre son programme en publiant un plan clé en main pour la gouvernance, baptisé Projet 2025. Présenté comme un guide de transition pour le prochain président conservateur, ce document de 900 pages détaillait comment reclasser les fonctionnaires sous une nouvelle appellation de catégorie F, purger les bureaucrates récalcitrants, rédiger des décrets présidentiels à l'avance et placer des fidèles à tous les niveaux de l'administration. Son postulat de base était vertigineux : une présidence moderne ne devrait pas dépendre du Congrès ni être entravée par les fonctionnaires de carrière. L'un des principaux auteurs du plan était Russell Vought. En tant que directeur du budget de la première administration Trump, il avait radicalement remanié le processus d'affectation des crédits, préconisant des blocages budgétaires pour imposer le respect des règles et utilisant l'annulation des crédits déjà approuvés comme moyen de pression. Il estimait que les agences indépendantes comme la FTC ou la Réserve fédérale étaient constitutionnellement suspectes, protégées uniquement par des décisions de justice obsolètes telles que l' arrêt Humphrey's Executor. Après le retour de Trump à la vie civile début 2021, Vought a redoublé d'efforts au lieu de se retirer. Il a fondé le Center for Renewing America et est devenu l'un des principaux architectes du Project 2025. Se déclarant fièrement « constitutionnaliste radical » et « nationaliste chrétien », il a insisté sur
Il est convaincu que les nouveaux arrivants s'identifient à sa vision du pays sur les plans religieux, culturel et historique. Il a également rapidement adhéré aux allégations de Trump concernant une élection volée, non par confusion, mais par pur intérêt personnel. C'était un signe de loyauté destiné à consolider sa place dans le cercle restreint de Trump et à garantir son influence en cas de retour au pouvoir des conservateurs.
Mais le véritable coup de génie de Vought n'était pas tactique, mais stratégique. Reagan avait tenté de réduire la taille de l'État en diabolisant les déficits. Vought, lui, l'a fait en qualifiant le gouvernement de corrompu. Il a présenté la fonction publique fédérale non pas comme inefficace, mais comme idéologiquement dangereuse : « woke », « marxiste », et séditieusement opportuniste.
Dès lors que la bureaucratie fut perçue comme une menace morale plutôt que comme un simple problème de gestion, sa purge cessa d'apparaître comme un acte de sabotage pour devenir une forme de légitime défense. C'est précisément ce que Reagan ne parvint jamais à faire : transformer la théorie d'un État minimal en une éthique populiste de purge.
En octobre 2024, Heritage publiait un ouvrage présenté ouvertement comme un complément au Projet 2025. Ce nouveau document, intitulé Projet Esther , prolongeait la logique de la rage de Vought et plaidait pour l'application des mêmes tactiques d'épuration utilisées contre la bureaucratie fédérale afin de discréditer les universités, les services de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) et les mouvements de protestation sur les campus. Sous-titrant l'ouvrage « Une stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme », les auteurs passaient rapidement de la condamnation des préjugés antisémites à la qualification des initiatives DEI sur les campus, de l'activisme pro-palestinien et de l'organisation antisioniste comme composantes de ce qu'ils appelaient le « Réseau de soutien au Hamas ».
Sous le régime d'application de la loi mis en place par Esther, le gouvernement fédéral devait se servir du Titre VI comme prétexte légal pour enquêter sur les universités et leur retirer leur financement si elles toléraient des propos ou des manifestations jugés « hostiles » ou préjudiciables psychologiquement aux étudiants juifs. De fait, la définition de l'antisémitisme fut élargie pour amalgamer l'antisionisme et le harcèlement, alors même que les membres de la Heritage Foundation accordaient relativement peu d'attention aux sources d'extrême droite et suprémacistes blanches à l'origine de la plupart des violences antisémites.
Cette approche a gagné du terrain durant la dernière année et demie de la présidence de Biden. Il s'y est opposé, mais s'est retrouvé largement impuissant : les républicains de la Chambre des représentants organisaient des auditions incessantes, les procureurs généraux conservateurs déposaient des plaintes acerbes et les donateurs exerçaient des pressions sur les universités pour obtenir leur soumission morale. Les présidents de Harvard, du MIT, de Penn et de Columbia ont été convoqués devant le Congrès et publiquement humiliés . Des enquêtes ont été ouvertes . L'administration est souvent apparue comme un simple spectateur plutôt que comme une force d'opposition.
Ces offensives culturelles et bureaucratiques se sont déroulées de concert. Heritage a fourni l'idéologie et les manuels. Vought, la stratégie et les listes de personnel.
La Cour suprême, désormais dominée par des juges sceptiques à l'égard de l'État administratif et favorables à un renforcement du pouvoir exécutif, a garanti le cadre juridique propice à la mise en œuvre de tels projets. L'arrêt Trump contre les États-Unis n'a pas initié ce changement ; il l'a simplement accéléré.
À la veille de l'élection présidentielle, la haine de la gauche atteignait des sommets parmi les partisans de Trump, l'administration était perçue comme obsédée par le « woke », et le monde universitaire était devenu synonyme d'antisémitisme. Mais le plus alarmant était que même les principaux démocrates étaient prêts à concéder un pouvoir unilatéral considérable à la présidence, sinon avec enthousiasme, du moins comme une fatalité.
Un des avocats qui m'avait représenté dans mes propres batailles contre le gouvernement m'a fait remarquer un soir, d'un ton morne, autour d'un cocktail, que nous entrions rapidement dans une phase de gouvernance post- Youngstown . Même mon Cosmo sans alcool en avait un goût amer.
Russell Vought occupait le centre de cet ordre émergent : défenseur acharné des économies budgétaires, nationaliste chrétien, auteur du Projet 2025 et défenseur cynique du grand mensonge de Trump.
Trump 2.0 – Les fous s’emparent de l’asile
Une fois que Trump a prêté serment une seconde fois, Vought était comme un lapin pris dans un filet de coton.
Confirmé et installé à l'OMB en quelques jours, il arriva cette fois non pas comme apprenti, mais comme détenteur du manuel de démolition. Il trouva immédiatement un allié en la personne d'Elon Musk, fraîchement recruté par Trump pour diriger le soi-disant Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), un plan grand public visant à « rationaliser » les agences fédérales.
Vought avait pris note quelques mois plus tôt lorsque Musk avait racheté Twitter et licencié près de 80 % de ses effectifs, se vantant que la plateforme fonctionnait toujours. Musk avait parlé de libération. Vought y voyait une preuve de concept.
Ainsi, lorsque Trump a chargé Musk de s'attaquer à la bureaucratie, Vought a réagi promptement. Il ne considérait pas DOGE comme un simple coup de théâtre, mais comme une opération de choc publique susceptible de démanteler les rouages mêmes de « l'État administratif » diabolisé par les projets 2025 et Esther .
Musk est resté suffisamment longtemps pour se lasser de partager la vedette avec Trump et les autres. Au bout de six semaines, il est retourné à son empire et à sa plateforme en ligne. Vought, quant à elle, est restée en place, transformant son plan de longue date en mesures concrètes : annulations de contrats, déclenchement de fermetures d’entreprises, et purges de personnel déguisées en réformes d’efficacité.
Au début du printemps, le modèle de gouvernance de la nouvelle administration s'était mis en place : la rapidité plutôt que le processus, la disruption comme doctrine, un personnel fédéral traité non pas comme un bien public mais comme une partie remplaçable.
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
« Depuis la fondation des États-Unis il y a 250 ans, aucun président américain n'a étendu son pouvoir — et puni ses détracteurs — de manière aussi effrontée et sans précédent que Donald J. Trump. »
C’est l’avis éclairé de deux journalistes avisés, Jim VandeHei et Mike Allen, qui ont récemment écrit dans Axios.
Depuis son investiture, selon eux, Trump a abusé de son pouvoir de déclarer l'état d'urgence nationale « pour contourner le Congrès et s'octroyer des pouvoirs extraordinaires ».
Ce qui paraissait autrefois impensable — déployer des troupes américaines sur le sol américain, poursuivre des entreprises de médias pour des critiques, cibler des opposants individuels, faire pression sur les universités pour qu'elles purgent leurs dirigeants ou réécrivent leurs politiques, voire exiger que les cabinets d'avocats et les entreprises paient sous peine de représailles — est devenu monnaie courante.
Chapeau à Jim et Mike pour leur analyse si pertinente des conséquences. Leur résumé constitue un prélude idéal à cette dernière étape de mon étude sur la manière dont l'expansion constante du pouvoir présidentiel a, une fois de plus, conduit Trump à un affrontement direct avec la démocratie américaine.
Si vous examinez de près le réservoir métaphorique qui alimente son retour, vous y trouverez trois sources d'énergie principales : la vengeance, le projet 2025 de Vought et une incompétence crasse.
Jetez un coup d'œil dans son rétroviseur et vous aurez bien du mal à apercevoir Youngstown .
La Cour suprême, imprégnée de l'idéologie MAGA, est aux commandes. Le Congrès, lui aussi sous influence MAGA, a troqué le contrôle contre l'obéissance. L'équilibre des pouvoirs, jadis sacré, ne sert plus qu'à museler les démocrates, les dissidents et tous ceux qui croient encore aux valeurs humanistes : pluralisme, libéralisme, voire simple décence.
Il faut bien le dire, les principaux instigateurs actuels de ce phénomène, le chef de la majorité à la Chambre des représentants, Mike Johnson, et ses semblables, sont les héritiers d'une faille originelle. Les Pères fondateurs supposaient que tout Américain blanc, de sexe masculin et propriétaire défendrait ses prérogatives. Des amendements ultérieurs ont étendu cette croyance à tous les citoyens. Mais personne n'avait anticipé un avenir où les réseaux sociaux pourraient pervertir la raison et soumettre des groupes entiers à une obéissance quasi sectaire.
Nous en sommes donc là : un Congrès passif, des tribunaux largement soumis et une présidence débridée. Il ne reste plus que la soif de pouvoir, de revanche et de vengeance d'un seul homme .
La première de ces impulsions est la dernière.
Si, comme l'a écrit Jonathan Lemire de The Atlantic , le secret pour comprendre un homme fort réside dans sa faiblesse, alors la faiblesse de Trump n'est pas l'insécurité liée au pouvoir mais à son héritage .
Il est obsédé par la façon dont ses nécrologies seront rédigées, si elles commenceront non pas par sa fortune ou sa présidence « historique », mais par ses trente-quatre condamnations pour crimes graves. Cette perspective le rend furieux, selon Lemire, et définit son instinct de gouvernement : la vengeance érigée en politique .
La volonté de Trump de punir ses ennemis est bien antérieure à ses passages à la Maison-Blanche et ne s'est jamais souciée des formalités légales. Dans les années 1980, il a fait paraître des encarts publicitaires dans les journaux réclamant la peine de mort pour les cinq adolescents noirs et hispaniques faussement accusés dans l'affaire de la joggeuse de Central Park : une condamnation avant procès, la décapitation avant même toute preuve.
Durant la campagne de 2016, il avait promis d'emprisonner Hillary Clinton pour avoir prétendument utilisé un serveur de messagerie privé pour des documents gouvernementaux, bien qu'aucune accusation n'ait jamais été portée. Une fois en fonction, il a fait pression sur le ministère de la Justice pour qu'il enquête sur Clinton, John Kerry, et même Barack Obama. Ses deux premiers procureurs généraux, Jeff Sessions et William Barr, ont parfois résisté , invoquant des normes qui empêchaient le ministère de se transformer en une escouade d'assassins personnelle.
C'était un défi de Sisyphe.
« Je veux mon propre Roy Cohn », s'est emporté Trump à un moment donné. Durant son second mandat, il a trouvé de nombreux volontaires.
Avec la fidèle Pam Bondi à la tête du ministère de la Justice et des idéologues comme Vought et Stephen Miller s'inspirant du Projet 2025 , les contraintes d'antan ont disparu. Le président utilise désormais l'État lui-même comme une arme, transformant le ressentiment en principe d'action.
Le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, et le maire de Chicago, Brandon Johnson, ont récemment été menacés d'emprisonnement pour avoir refusé de déployer des troupes, refus fondés uniquement sur la volonté du président et non sur une loi applicable. Des mises en accusation sommaires ont été prononcées contre l'ancien directeur du FBI, James Comey , son ancien conseiller, John Bolton , et l'ancienne procureure générale de New York, Letitia James , tous trois ayant, à leur manière, déplu au président.
Ces gestes illustrent de façon dramatique comment la vengeance s'est mêlée à la gouvernance.
Cette fusion a pris forme doctrinale dans le Mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale 7 (NSPM-7), que Trump a signé le 25 septembre. L'ordonnance ordonne aux groupes de travail conjoints sur le terrorisme du FBI d'« enquêter, de poursuivre et de perturber » les réseaux impliqués dans « la violence et l'intimidation politiques », tout en énumérant des « marqueurs » idéologiques tels que l'anti-américanisme, l'anticapitalisme et l'anti-christianisme.
Le Trésor est habilité à couper les fonds aux organisations à but non lucratif ou aux donateurs jugés « soutien ou incitation » à la dissidence. Comme l’a déclaré un critique au magazine Time : « L’objectif est de faire taire les individus et les groupes par la menace de représailles. »
Sans blague.
Cette directive faisait suite à l' assassinat du militant d'extrême droite Charlie Kirk, une tragédie que Trump et Miller ont immédiatement présentée comme une preuve du « terrorisme d'extrême gauche ».
Quelques jours plus tard, la Maison-Blanche lançait sa campagne « ennemi intérieur ». Lors d'un discours à Quantico, Trump déclara à des centaines de généraux et d'amiraux que les villes dirigées par les démocrates devraient servir de « terrains d'entraînement » pour les troupes afin d' écraser les ennemis intérieurs. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, promit d'abolir le contrôle de l'inspection générale et de rétablir la discipline au sein des forces armées.
Les applaudissements du président ont étouffé un siècle de retenue entre les pouvoirs civils et militaires. Comme l'avait averti le juge Jackson dans l'affaire Youngstown , le commandant en chef qui agit « au plus bas » sans cadre légal risque de transformer les pouvoirs d'urgence en administration courante.
Trump tente de se justifier a posteriori. Il invoque régulièrement la loi sur l'insurrection de 1807, qui autorise un président à déployer des troupes sur le territoire national lorsque les autorités étatiques sont « incapables ou refusent » de maintenir l'ordre, et il cite la loi sur les étrangers ennemis de 1798 comme précédent pour justifier la détention ou l'expulsion de ceux qu'il qualifie de menaces.
Stephen Miller appelle désormais cela « l'autorité plénière » du président. Les constitutionnalistes, quant à eux, le qualifient de ce qu'il est : une tentative d'effacer les frontières juridiques entre le maintien de l'ordre et la guerre.
La logique se propage à l'étranger. Le mépris de Trump pour le droit national trouve un écho outre-mer. Dans les Caraïbes, il a ordonné des frappes meurtrières contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue, faisant environ quatre-vingts victimes, sans aucune autorisation du Congrès.
La leçon à tirer est glaçante. Lorsque la présidence se mue en justicière sur le plan intérieur, l'anarchie à l'étranger s'ensuit inévitablement. La frontière entre vengeance et sécurité nationale disparaît.
Thomas Edsall, du New York Times, qualifie ce schéma de guerre civile fabriquée de toutes pièces , une stratégie de crise perpétuelle qui justifie un pouvoir perpétuel. Chaque outrage rend le suivant plus acceptable. Le ministère de la Justice inculpe d'anciens responsables. Le Trésor étouffe les institutions dissidentes. L'armée s'entraîne à des opérations de répression urbaine. L'arrêt de la Cour suprême dans l' affaire Trump contre les États-Unis accorde une large immunité aux « actes officiels ». Le Congrès, paralysé par les luttes intestines, intervient rarement.
Ainsi, ce à quoi nous assistons n'est pas simplement une soif de vengeance débridée, mais une doctrine de gouvernement qui pervertit la loi au profit de la punition. Pas à pas, Trump apprend au pays à vivre sans les limites qui définissaient autrefois une république.
Nombreux sont ceux qui, ne pouvant le supporter, se consolent en pensant qu'une fois parti, le système reprendra son cours normal.
C'est une illusion. Il n'y a pas de « normalité » à laquelle revenir, si tant est qu'il y en ait jamais eu une. Les patriarches du mouvement conservateur – Vought et les héritiers obsédés par Burke, fondateurs de la Federalist Society et de la Heritage Foundation – ont trouvé en Trump l'instrument idéal : une sorte de pantin, dont les pulsions et les griefs peuvent être instrumentalisés dans le cadre d'une stratégie à long terme.
Par son intermédiaire, ils remodèlent la présidence, la bureaucratie et le système électoral d' une manière qui lui survivra largement.
Trump a un jour affirmé n'avoir jamais entendu parler du Projet 2025. Aujourd'hui, il se vante que le secrétaire au budget, Vought, soit « célèbre pour ce projet». C'est révélateur. Vought et ses complices, qui ont contribué à l'élaboration du plan, s'emploient activement à le traduire en directives, à procéder à des purges et à mener des campagnes de pression.
La question n’est pas de savoir si l’autoritarisme de Trump va s’essouffler — il ne s’essoufflera pas — mais à quel point il va s’enraciner dans le tissu politique américain.
VandeHei et Allen d' Axios apportent un constat alarmant. Dans leur récent article « Dans les coulisses » , ils recensent quinze mesures inédites prises par Trump 2.0.
À la lumière de leur liste et du Projet 2025 , le danger apparaît clairement. Les excès de Trump ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont minutieusement planifiés et, une fois mis à l'épreuve, ils deviennent des précédents que tout successeur peut invoquer.
Pourquoi cela se déroule-t-il si vite ?
Car presque chaque action de Trump commence désormais par le discours de l'urgence, une stratégie que Vought préconise depuis longtemps. En moins d'un an, Trump a déclaré au moins neuf « états d'urgence », à tel point que le terme en a perdu tout son sens. Axios y voit un précédent majeur : le recours systématique au droit d'urgence pour contourner le Congrès.
Cette logique fait écho au Projet 2025 , qui exhorte les futurs présidents à normaliser la gestion des crises et à gouverner par dérogation pendant que le Congrès débat de la procédure.
Rien n'illustre mieux ce modèle que l'offensive de Trump contre la presse. Nixon tenait une liste d'ennemis. Trump, lui, intente des procès, asphyxie les médias publics et incite les autorités de régulation à harceler les organes de presse critiques. Axios qualifie cette campagne de « campagne la plus agressive contre les médias traditionnels de l'histoire moderne des États-Unis », un modèle pour tout futur président désireux de contrôler l'information.
Au sein même de l'appareil sécuritaire, Trump agit avec la même vigueur, imposant des tests polygraphiques aléatoires à ses collaborateurs et des engagements de confidentialité similaires à ceux de Snepp. Il a également exigé que les journalistes couvrant le Pentagone signent de tels accords. Ces règles de bâillonnement transforment la collecte d'informations en un privilège conditionnel.
L'objectif plus large, conforme à la doctrine Heritage , est d'aveugler les organismes de surveillance, de renforcer le contrôle du récit national et de s'assurer que chaque message, du coup de gueule de Fox News aux notes de service, suive le même scénario.
Si la Cour suprême restreint la portée de l'arrêt New York Times v. Sullivan , comme l'ont suggéré certains militants pro-Trump, le cadre juridique pourrait se durcir davantage. Abaisser le seuil de la diffamation permettrait aux autorités de discréditer bien plus facilement leurs détracteurs devant les tribunaux.
La même pression s'exerce sur les professions libérales et le monde universitaire. Trump a sanctionné des cabinets d'avocats pour avoir représenté des adversaires, a annulé des contrats et des habilitations de sécurité, et a gelé des milliards de dollars de subventions aux universités tant qu'elles n'auront pas changé de direction ou protesté contre leurs politiques. Axios considère ces campagnes menées par Vought comme des précédents d'utilisation de fonds fédéraux à des fins de répression idéologique. Le Projet 2025 et son pendant, le Projet Esther, officialisent cette approche : chaque subvention est un moyen de pression, chaque institution un laboratoire de conformité.
La santé publique a elle aussi été politisée . Les scientifiques sont marginalisés, la recherche est réduite, et les décisions de la FDA et du CDC sont détournées par des personnes qui leur sont fidèles. Axios attribue ce phénomène à la propension de Trump à instrumentaliser l'expertise comme levier de contrôle, conformément au plan de la Heritage Foundation visant à démanteler l'État expert et à placer la politique de santé sous l'autorité présidentielle.
Le mépris de Trump pour la loi s'étend à la Constitution elle-même. En témoigne sa tentative renouvelée de supprimer, par décret, le droit du sol, garanti par le 14e amendement.
Axios le qualifie de précédent parmi les plus spectaculaires en cours d'élaboration : s'il résiste à une contestation judiciaire, n'importe quel président pourrait redéfinir les droits fondamentaux par simple proclamation.
L'affaire est désormais portée devant la Cour suprême (voir ci-dessous). La pression politique en faveur d'une décision favorable à Trump est intense. Ce décret s'inscrit pleinement dans la ligne dure du Projet 2025 en matière d'immigration et prône une « réinterprétation personnelle de la Constitution » . Vought et ses coauteurs soutiennent depuis longtemps que le président devrait imposer sa propre interprétation de la Constitution par voie de décret. Or, c'est précisément ce que fait ce décret.
Leur objectif profond est idéologique : rejeter les « réinterprétations progressistes » de la Constitution et rétablir une approche « originaliste ». Concrètement, cela signifie redéfinir les droits comme étant conditionnels. Si le décret de Trump est validé, une garantie constitutionnelle deviendrait subordonnée à la définition exécutive de la légalité de la présence sur le territoire, et le président serait placé au-dessus du Congrès et du pouvoir judiciaire.
C'est le cas de test d'exécutable unitaire que Heritage attendait.
Entre-temps, Trump a considérablement accru ses pouvoirs de commandant en chef. Parmi les exemples les plus flagrants, citons les frappes navales unilatérales tristement célèbres au sud de la frontière, le déploiement d'unités de la Garde nationale pour renforcer les forces de police locales malgré les objections des États, et le recours à la loi sur les étrangers ennemis pour expulser des membres présumés de gangs. Il a également mis en place des centres de détention provisoire, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, pour les personnes accusées de délits et a envoyé des agents de l'ICE masqués dans nos villes afin d'instiller la peur et la soumission parmi la population.
Axios envisage la fusion des pouvoirs en temps de guerre et en temps de paix en un seul champ continu. Le Projet 2025 soutient explicitement une présidence affranchie des contraintes liées aux pouvoirs de guerre.
En se proclamant « principal responsable de l'application des lois » aux États-Unis, Trump a de facto aboli la frontière entre la Maison-Blanche et le ministère de la Justice. Axios avertit que si cette situation perdure, les futurs présidents pourront lancer ou bloquer des enquêtes à leur guise. Le Projet 2025 leur fournit le prétexte, en redéfinissant le rôle du procureur général comme un instrument de la volonté présidentielle.
Au nom de l'efficacité bureaucratique, il a limogé les inspecteurs généraux, réduit au silence les organes de contrôle et remplacé les fonctionnaires de carrière par des fidèles. Axios dénonce un système de favoritisme à l'échelle de l'État moderne. Le Projet 2025 qualifie ces entités de « quatrième pouvoir » incontrôlable et propose des solutions : étendre la réglementation fiscale, assimiler toute dissidence à du sabotage et soumettre le contrôle à l'obéissance.
La même logique – transformer chaque fonction publique en instrument de contrôle – s'étend à la politique budgétaire. Axios recense une série de « suspensions » et de détournements de fonds approuvés par le Congrès : aides suspendues, subventions gelées, budgets bloqués. VandeHei et Allen y voient une manœuvre permettant aux présidents de manipuler le pouvoir budgétaire conféré par l'article I.
Heritage avait anticipé précisément cela : rétablir le gel des crédits budgétaires de l’ère Nixon, confier le contrôle budgétaire à la Maison-Blanche et transformer les dépenses en un test de loyauté. Chaque « blocage temporaire » inverse l’ordre constitutionnel. Le Congrès vote ; le président décide.
La politique commerciale a elle aussi été profondément remaniée. Les droits de douane, instrument constitutionnellement législatif, sont désormais l'outil de prédilection de Trump pour sanctionner son commerce. En l'absence d'intervention de la Cour suprême, Axios entrevoit la création d'un nouveau précédent : les présidents seraient libres d'instrumentaliser le commerce à leur guise. Le Projet 2025 en fournit la justification : qualifier tout différend de « sécurité nationale », marginaliser l'OMC et le Congrès, et mener la politique industrielle depuis la Maison-Blanche.
Sur le plan monétaire, Trump a fait pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle baisse les taux et a même envisagé de limoger un gouverneur en exercice, une proposition qu'Axio qualifie de rupture avec les normes établies. Heritage parle quant à elle de cohérence politique, d'une technocratie soumise à la volonté de l'exécutif.
Alors que beaucoup d'entre nous s'inquiétaient d'autre chose, Trump a également transformé une grande partie de l'économie en un système clientéliste. « Capitalisme du clientélisme », c'est ainsi qu'Axios exprime l' indignation générale. Cela se traduit par des participations au capital pour des entreprises privilégiées, des systèmes de notation de la fidélité pour les prestataires, et des subventions servant de récompense politique. Le Projet 2025 présente tout cela comme un nationalisme économique, faisant du président le principal responsable des investissements.
Finalement, la clémence, autrefois discrétionnaire, est devenue un gage de loyauté. Les grâces massives accordées par Trump aux accusés du 6 janvier ont créé un précédent auquel les futurs présidents auront du mal à résister : agissez pour le chef, et la loi vous épargnera. Le Projet 2025 nous invite à considérer l’élargissement de la clémence comme un remède aux « abus de pouvoir administratif ». En pratique, il troque l’immunité contre la fidélité.
L' analyse d'Axios est sans équivoque . Les violations répétées du droit et du protocole par Trump ne sont pas des incidents isolés. Elles constituent les fondements d'un nouveau système. Chaque impulsion devient une règle. Chaque infraction, un modèle. Les pouvoirs d'urgence deviennent la norme. Les crédits budgétaires deviennent facultatifs. L'expertise et l'indépendance deviennent superflues.
Trump donne l'impulsion. Le Projet 2025 montre la voie. Ce qu'Axios appelle « nouveaux précédents » n'est en réalité que la transformation de cette impulsion autoritaire en structure, la normalisation de la gouvernance par exception.
Une fois ancrés dans la pratique, les précédents demeurent, attendant que celui qui viendra ensuite les reprenne.
Le dernier front : la Cour et les limites du pouvoir présidentiel
Alors que nous entamons la dernière étape de ce reportage, quelques remarques contextuelles s'imposent.
Dans ce bourbier, on ne trouve aucune trace de la fameuse affaire Epstein et de son potentiel à faire dérailler la présidence de plus en plus autoritaire de Trump. Ce scandale pourrait bien lui être fatal. Mais il a fait obstruction à toute transparence comme si sa vie en dépendait, et je ne serais pas surpris que certains des documents les plus révélateurs aient été discrètement modifiés, voire tout simplement perdus, au fil des ans.
La succession d'Epstein, quelles que soient ses contours exacts, a été décrite comme dépositaire d'un ensemble de dossiers. Ses propres responsabilités pourraient bien l'empêcher de tout divulguer, et sans porter de jugement, force est de constater qu'elle a eu amplement l'occasion de modifier ou de supprimer des éléments si elle l'avait souhaité. Il en va de même pour le ministère de la Justice de Trump, autre dépositaire de preuves cruciales, qui a ses propres raisons de s'opposer à une divulgation publique complète.
Les victimes d'Epstein conservent peut-être des souvenirs précis, mais nous avons constaté à quel point leur crédibilité s'érode dès lors que des avocats influents s'attardent sur les incohérences temporelles et s'interrogent sur les raisons pour lesquelles les victimes n'ont pas parlé plus tôt. E. Jean Carroll a survécu à cette épreuve – et a obtenu gain de cause au civil contre Trump pour agression sexuelle présumée – mais même elle a dû subir un niveau d'exposition médiatique qui aurait brisé une personne moins aguerrie.
L'affaire se complique encore davantage lorsque l'argent entre en jeu. Certaines victimes auraient reçu des paiements d'Epstein ou de Ghislaine Maxwell : réparations, argent pour acheter le silence, ou encore des formes de compensation. Il est quasiment impossible, a posteriori, de démêler les motivations, le sens de ces actes et le consentement des victimes. Et dès lors que d'importantes sommes sont en jeu, même les survivantes les plus méritantes peuvent voir leur crédibilité morale remise en question par ceux-là mêmes qui, en temps normal, leur témoigneraient une sympathie inconditionnelle.
L'histoire nous met également en garde contre la sous-estimation de la ténacité de la base politique de Trump. Le versement d'une indemnité à Stormy Daniels et la diffusion de l'enregistrement d'Access Hollywood auraient mis fin à la carrière de presque n'importe quelle autre personnalité publique. Pourtant, ses partisans, dont beaucoup sont des traditionalistes attachés aux valeurs morales, ont trouvé le moyen de lui pardonner suffisamment longtemps pour le renvoyer à la Maison-Blanche.
Compte tenu de tout cela, il semble prématuré de prédire comment le scandale Epstein pourrait affecter la seconde présidence de Trump, ou même ses plus fervents partisans. La plupart des Américains connaissent déjà suffisamment le caractère de Trump pour se forger une opinion : ils le perçoivent, à juste titre, comme un véritable scélérat.
Ceci étant dit, revenons aux questions juridiques et politiques qui nous ont amenés jusqu'ici.
Personnellement, je ne suis pas heureux. En mai 2022, la Cour suprême a rejeté la requête de la Fondation Knight visant à faire réexaminer l' affaire Snepp , celle-ci ayant été profondément lésée lors du premier examen. Le rejet a été sans appel : pourvoi refusé . Je me retrouve donc muté au silence à vie, dans la misère et avec un sentiment de trahison. Et tous ceux qui, dans le pays, s'opposent à l'appareil sécuritaire de Trump risquent de subir le même sort .
Mais ne pleurez pas pour moi, Argentine. Il y a des chats à fouetter bien plus gros que ça.
Les manifestations massives « Non aux rois » et la récente victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat ont témoigné d'un mécontentement généralisé à l'égard des objectifs et du style de gouvernement de Trump. Mais le revirement spectaculaire des démocrates au dernier moment dans la bataille pour le blocage budgétaire, leur abandon soudain de la réforme de la santé comme condition sine qua non à la réouverture du gouvernement, ont ravivé de vives querelles internes au sein du parti.
Cela a également incité tout le monde à s'interroger à nouveau sur la légitimité du parti d'opposition à reprendre les rênes. Le grand chapiteau a été arraché de son mât central.
Mais le destin s'est aussi montré capricieux envers Trump. Alors même qu'il savoure sa victoire sur les progressistes et leurs alliés dans la bataille contre le blocage budgétaire, la Cour suprême examine une nouvelle série d'affaires qui pourraient accroître considérablement les pouvoirs de la présidence – ou les lui ôter purement et simplement.
Malgré tout ce que j'ai dit ici, rien n'est encore joué dans un sens ou dans l'autre.
Bien que la tendance semble s'être confirmée dans l'affaire Trump contre États-Unis , mon précédent préféré, Youngstown , n'est pas totalement abandonné. En 2022, le juge en chef Roberts a créé de toutes pièces une nouvelle règle empirique : la doctrine des questions majeures . Celle-ci reconnaît, au moins de manière imparfaite, l'importance de s'en remettre à la loi en vigueur pour déterminer les limites du pouvoir présidentiel.
Gardons cela à l'esprit tandis que nous tentons de déterminer où mène la présidence impériale, compte tenu des contradictions et des complexités qui affectent le rôle actuel de la Cour.
Tout d’abord, le grand angle – histoire de se le rappeler :
Pendant près de quatre-vingts ans, de la réquisition de l'acier par Truman à la purge de la fonction publique menée par Trump, l'histoire de la présidence a été celle d'une expansion constante. Comme j'ai tenté de le démontrer ici, chaque occupant de la Maison-Blanche a découvert de nouveaux outils unilatéraux. Et chaque Cour suprême a décidé jusqu'où elle voulait laisser cette expérience se poursuivre.
Les réformes post-Watergate, censées limiter les abus de pouvoir de l'exécutif, les ont au contraire institutionnalisés . En tentant de contrôler la présidence, le Congrès l' a dotée d'un nouvel arsenal juridique, comprenant des lois d'urgence, des dérogations réglementaires et des failles juridiques liées à la sécurité nationale, que tous ses successeurs ont appris à exploiter. Ce qui était conçu comme un frein aux excès à la Nixon est devenu un moyen de contourner la loi pour agir de la même manière.
Aujourd'hui, au sommet du second mandat de Trump, cette quête toujours plus rapide d'un pouvoir personnel atteint un point critique sur le plan constitutionnel . De fait, la session actuelle de la Cour suprême constitue un référendum sur la présidence elle-même : jusqu'où peut-elle s'étendre, et les juges qui ont contribué à son expansion sauront-ils enfin fixer des limites ?
Le 5 novembre, la Cour a entendu les plaidoiries dans une affaire cruciale, Learning Resources, Inc. c. Trump , jointe à VOS Selections, Inc. c. Trump .
La salle était comble, et à juste titre. Les avocats de Trump ont insisté sur le fait que la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA) autorise un président à imposer des droits de douane généralisés lors d'une situation d'urgence auto-déclarée. Ce garde-fou contre les abus de pouvoir exécutif, instauré après le scandale du Watergate, est devenu le dernier instrument de pouvoir de Trump.
Dès le « Jour de la Libération » en avril dernier, il avait imposé des droits de douane sur la quasi-totalité des importations, invoquant à la fois des raisons de sécurité nationale et l'impératif de relance industrielle. La logique était du pur Trump 2.0 : agir d'abord, déclarer l'urgence, défier le Congrès d'annuler ces mesures. À la Maison-Blanche, ses conseillers décrivaient ces droits de douane comme l'essence même de sa philosophie de gouvernement, la volonté présidentielle étant le moteur de la vie économique.
Lors des plaidoiries, la quasi-totalité des juges a exprimé son scepticisme. Même les conservateurs ont hésité à qualifier d’« urgence » un demi-siècle de déficits commerciaux. « Si cela en est une », a demandé le juge Neil Gorsuch au procureur général de Trump, « qu’est-ce qui ne le serait pas ? »
Dans un commentaire diffusé sur CNN , Noah Feldman, professeur à Harvard, a fait remarquer que la surtaxe temporaire instaurée par Nixon en 1971, désormais invoquée par le gouvernement comme précédent, n'était qu'une « brèche dans la porte, et non un prétexte pour la faire sauter ». John Yoo, ancien avocat de Bush et fin connaisseur des théories sur un pouvoir exécutif autoritaire, a déclaré au même public de CNN : « Si c'est une urgence, alors tout l'est. »
S'exprimant depuis le banc, le juge en chef Roberts a rappelé sa propre doctrine des questions majeures, selon laquelle les présidents ne peuvent s'arroger de vastes pouvoirs dans d'anciennes lois que si le Congrès les leur a expressément accordés. Roberts avait d'abord utilisé cette théorie pour bloquer les initiatives de Biden concernant les prêts étudiants et le climat. Il semblait désormais prêt à l'utiliser contre Trump. Logiquement, ce retournement de situation est justifié. Après tout, l' IEEPA n'a jamais été interprétée comme autorisant un régime tarifaire mondial. Selon le critère de Roberts , le silence ne vaut pas consentement.
Une large victoire du gouvernement ici légitimerait la doctrine de l'état d'urgence permanent prônée par Trump. Une défaite sans équivoque pourrait constituer le premier véritable frein à l'exercice unilatéral du pouvoir depuis des décennies.
Au-delà des apparences, l'enjeu sous-jacent de cette affaire touche à l'autorité même du pouvoir judiciaire. Trump a déjà mis en garde les juges contre des « décisions timides », laissant entendre qu'il pourrait s'opposer à toute restriction.
Quel que soit le résultat, l'affaire Learning Resources donnera le ton pour l'ensemble de la session. La Cour réexamine actuellement les doctrines mêmes qu'elle a élargies par le biais de la procédure parallèle, ces décrets d'urgence non signés qui ont permis à Trump de relancer des politiques bloquées par les juridictions inférieures : les licenciements de la catégorie F, les reculs en matière environnementale, les expulsions massives.
Aucun de ces textes n'avait de précédent formel, mais ensemble, ils ont remodelé la présidence.
Il appartient désormais aux juges de décider si ces improvisations deviendront loi permanente. Trois affaires en cours permettent d'en tester les limites.
L'affaire Trump contre Slaughter pose la question de savoir si le président peut révoquer à sa guise des fonctionnaires d'agences « indépendantes » comme la FTC et la SEC, annulant de fait l'arrêt Humphrey's Executor contre les États-Unis (1935), la décision qui garantissait autrefois leur autonomie.
L' affaire Trump contre CASA déterminera s'il peut redéfinir les droits constitutionnels par décret. Son ordonnance révoquant le droit du sol, initialement validée en procédure préliminaire, fait désormais l'objet d'un débat approfondi.
L' affaire Cook contre Trump conteste le limogeage par Trump de la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, une décision qui, si elle était confirmée, placerait la banque centrale du pays directement sous le contrôle de la Maison Blanche.
Chaque cas illustre la même logique qui anime Learning Resources : la vision d'un « exécutif unitaire » dont la portée n'est limitée que par la propre déclaration d'urgence de Trump.
L'ironie, c'est que ces litiges sont le fruit de la complaisance de la Cour. Durant les premiers mois du retour au pouvoir de Trump, la majorité a instrumentalisé l'urgence pour accorder un pouvoir discrétionnaire, octroyant des mesures « temporaires » qui semblaient permanentes. Elle doit désormais en assumer les conséquences.
Une décision favorable à Trump dans l' affaire Slaughter anéantirait le dernier vestige d'indépendance gouvernementale ; dans l'affaire CASA , elle lui permettrait de définir qui est citoyen ; dans l' affaire Cook , elle politiserait la politique monétaire. Si l'on ajoute l'affaire Learning Resources , presque tous les leviers majeurs de la vie nationale – commerce, réglementation, immigration, finance – graviteraient autour du Bureau ovale.
La manière dont la majorité traitera ce dossier révélera si la Cour Roberts restera conservatrice ou s'orientera vers un pouvoir exécutif assumé. Roberts et Gorsuch ont parfois hésité à surinterpréter les pouvoirs présidentiels, tandis qu'Alito et Thomas semblent s'en délecter. Barrett et Kavanaugh se situent entre les deux, prônant la retenue tout en votant pour une plus grande autonomie. Le choix qu'ils feront maintenant déterminera la nature de la présidence pour toute une génération.
C’est dans ce choix que réside la mesure ultime de l’héritage de Trump. Si la Cour continue de considérer l’urgence comme une autorité et que le Congrès continue de s’en remettre à elle, l’état de droit deviendra rétroactif, et l’édifice de la retenue cédera la place à une politique de l’effet d’entraînement.
Voilà la transformation constitutionnelle de notre époque : la fusion de la volonté politique et de la complaisance judiciaire au sommet de l’État. Il ne s’agit pas simplement de la méthode Trump. C’est le nouveau modèle de la présidence américaine, un système où le pouvoir s’étend en catimini et où la loi intervient trop tard pour l’enrayer.”